Un uomo che valuta
it-IT fr-FR
Un homme qui évalue
Une journée imaginaire dans la vie d’un chercheur précaire
20 febbraio 2019
20 février 2019

Immagina di vivere in un mondo in cui la valutazione è dappertutto. Sei in una città europea, ma potresti anche essere negli Stati Uniti, l’importante è che tu sia da qualche parte in Occidente, in uno Stato cosiddetto liberale, e che tu sia là in questi anni, in questi giorni. Immagina di essere in Italia, a Milano, a Roma, oppure – perché no ? – a Trieste. Ma potresti anche essere in Francia, immagina, per esempio, di essere a Parigi. Sei uno dei tantissimi italiani che vivono a Parigi, che cercano lavoro, che trovano lavoro, che perdono il lavoro. Magari sei un cosiddetto lavoratore cognitivo – statuto che non si riesce mai a definire esattamente, eppure tutti sanno che cos’è –, hai fatto un dottorato, potresti persino averne fatti due – no, non è il tuo caso –, però hai fatto più di un post-doc. Immagina di svegliarti la mattina nel tuo appartamento e di dividere la tua giornata in due : di mattina studi e scrivi per trovare un’altra borsa di ricerca, di pomeriggio cerchi un lavoro qualsiasi, senza sapere esattamente quale, magari un boulot alimentaire – come dicono in Francia –, un lavoro tanto per campare, o forse no, cerchi il lavoro della vita, cerchi una svolta. Comunque sia, immagina di vivere in un mondo in cui la valutazione è dappertutto.
Già, perché di mattina, quando studi e scrivi e fai progetti per trovare una borsa di ricerca, hai costantemente a che fare con i meccanismi di valutazione che devono vagliare, discriminare, selezionare, gerarchizzare quei progetti. Meccanismi, macchine, dispostivi, apparati, congegni, procedure, processi, sistemi, metodi, norme – pensi. Sai che la domanda che hai presentato per una certa borsa è la numero tremilacinquecentoeccetera, sai che a ogni domanda corrispondono due lettere di raccomandazione scritte da autorevoli personalità scientifiche che valutano le qualità del candidato come eccellenti, non comuni, pregevoli, assolutamente rimarchevoli, sai che a tremilacinquecentoeccetera progetti – ma forse sono di meno, forse non tutti coloro che hanno attivato la procedura on-line per candidarsi e hanno ricevuto un numero di serie hanno poi portato a termine la domanda, poniamo che siano meno della metà, cioè millecinquecentoeccetera –, quindi sai che a millecinquecentoeccetera progetti corrispondono tremilaeccetera lettere di raccomandazione. Capisci che esiste una produzione su scala industriale di queste lettere e supponi che ci siano autorevoli personalità scientifiche che passano buona parte del loro tempo, quando la scadenza per la presentazione della domanda per una borsa si avvicina, a scrivere lettere di presentazione per persone che forse conoscono appena. Ti passa persino per la testa di intraprendere un’attività imprenditoriale di produzione di lettere di presentazione conto terzi, ci ridi sopra e trasferisci il balzano progetto nella seconda parte della giornata, quella in cui ti dedichi alla ricerca di un lavoro. Immagina di conoscere bene i meccanismi, i dispositivi, le procedure di valutazione dei progetti, perché ti è capitato, nel tuo piccolo, di prendervi parte come valutatore, e quindi sai bene che cosa significa effettuare una valutazione formalizzata attraverso un processo di double-blind peer review. Ti chiedi come faranno i valutatori a gestire una tale mole di progetti da valutare in tempi brevi, essendo – anche questo lo sai – la qualità media dei progetti molto alta, e ti rispondi che, in assenza di una macchina informatica in grado di gestire contemporaneamente l’aspetto oggettivo e soggettivo della valutazione, saranno la sorte e i rapporti di forza accademici a fare selezione.
Capisci che le borse che hai vinto fino a oggi le hai vinte grazie all’orrido e immorale caso – la fortuna di imbattersi in un referee favorevole, per esempio – e non tanto perché un gioco di valutazioni incrociate abbia reso infine giustizia al tuo merito. Immagina di chiederti il motivo di tale immane sforzo di valutazione e di altrettanto gigantismo burocratico, se è vero che l’elemento del caso, l’al di là del bene e del male che la buona valutazione – quella giusta – dovrebbe scacciare, finisce sempre per rientrare della finestra. Ti viene in mente di aver letto un libro di Béatrice Hibou che si intitola La bureaucratisation du monde à l’ère néolibérale, che ti ha indicato nella burocratizzazione della politica, della pubblica amministrazione e della vita quotidiana il correlato di un governo neoliberale, e così non riesci a fare a meno di mettere in fila, in un catalogo infinito, tutte le pratiche burocratiche e di valutazione in cui sei coinvolto in questo esatto momento : ti sei iscritto al collocamento, hai chiesto il reddito minimo, stai cercando un altro appartamento in affitto, devi rinnovare la domanda di iscrizione alla biblioteca nazionale, hai aperto un conto in banca, stai per chiedere l’assicurazione sanitaria, hai inviato un articolo a una rivista, ti sei candidato per alcune borse di ricerca, ti sei candidato per diversi posti di lavoro – per ognuna di queste cose hai dovuto presentare un nutrito dossier pronto per un’attenta attività di valutazione. Ognuna di queste pratiche, presa singolarmente, è necessaria, è opportuna, quasi scontata, non c’è dubbio ! – pensi –, ma all’improvviso le consideri come un insieme, le immagini come un complesso non privo di un’involontaria coerenza. Senza contare il numero di questionari di valutazione che compili quando usufruisci di servizi su internet o per telefono, e d’un tratto ti ricordi anche i questionari che hai somministrato agli studenti dell’università, quelli che hai compilato quando hai seguito dei corsi come allievo, gli infiniti questionari di valutazione che gestivi quando lavoravi in un’azienda e avevi a che fare con il suo sistema qualità ISOqualchecosa. Ti ricordi la fine che facevano quei questionari, ti ricordi gli aggiustamenti, i piccoli trucchi per far combaciare le cose, per evitare problemi, per adempiere gli innumerevoli obblighi imposti dal sistema. Ti ricordi le statistiche che ne seguivano, e i loro usi propagandistici. Ti ricordi pure di aver letto, una volta, un manuale di management dedicato alle pratiche di valutazione del lavoro, un volume collettivo, e ricordi che uno degli autori, in uno slancio di franchezza, confessava che tali pratiche si rivelano, in fondo, inefficaci dal punto di vista del raggiungimento degli obiettivi che esse stesse si pongono. E tuttavia – diceva – vanno messe in opera, perché creano un clima di giustizia organizzativa, senza il quale, al giorno d’oggi, non è possibile motivare le persone. Quindi ripensi al libro di Béatrice Hibou sulla « burocratizzazione del mondo » e constati che risuona con la tua esperienza quotidiana. Comprendi che valutazione e burocrazia sono come due specchi contrapposti, e che quando si afferma la necessità di smontare i moloch burocratici del passato, della scienza dell’amministrazione del Novecento, in nome della flessibilità, beninteso, dell’appiattimento delle gerarchie, dell’empowerment, della « proattività », della presa di iniziativa individuale, della responsabilità, della creatività, allora un nuovo sistema (post)burocratico si disegna sullo sfondo di questi discorsi, e « valutazione » è il nome che più gli corrisponde. Stai immaginando di vivere in un mondo in cui la valutazione è dappertutto. Poi ti ricordi di aver studiato Michel Foucault e che in Italia è uscito un libro sulla cultura della valutazione che si intitola significativamente Valutare e punire, l’autrice si chiama Valeria Pinto. Immagina di procurarti quel libro, sai che un tuo amico italiano lo possiede, te lo presta, ecco, immagina di averlo già letto. Attraverso quel libro scopri una letteratura critica sul tema della valutazione che non conoscevi, e che ti parla di « audit society » o « evaluative society », di « inspection age », che ti parla della valutazione come tecnologia di governo, come modo di esistenza dello stato neoliberale. Allora vai a rivedere un libro di Foucault che si intitola Nascita della biopolitica, immagina di andare a recuperarlo nella pila di libri che hai accatastato sulla scrivania e di individuare quasi subito le pagine che ti interessano, pagine che, a suo tempo, avevi appuntato e sottolineato, pagine che ora rileggi quasi con una certa agitazione. Immagina di immaginarti di spiegare a un pubblico quello che stai leggendo, come se fossi in classe o in aula, perché è questo che fai sempre quando cerchi di fissare dei concetti o di chiarirli a te stesso. Così immagini, senza nemmeno rendertene conto, di fare una lezione in cui riassumi alcuni aspetti delle analisi del neoliberalismo condotte da Foucault in Nascita della biopolitica, che poi è l’edizione del corso che Foucault tenne al Collège de France nel 1979. « Ecco, vedete » – ti ritrovi a sussurrare in un’aula immaginaria – « Foucault, nel 1979, proseguirà la propria ricerca intorno alla razionalità di governo liberale e neoliberale come quadro di intelligibilità della biopolitica, insistendo ancora una volta sul venir meno delle tecnologie disciplinari in quanto cifra o forma egemone dell’esercizio del potere nelle società occidentali. La governamentalità dei nostri giorni, e forse anche quella a venire, si effettua per lo più a livello di una “tecnologia ambientale” che opera intorno agli individui, all’interno dei loro campi di “gioco”, arretrando in modo massiccio rispetto alla “tecnologia umana” dei sistemi normativo-disciplinari ». Stai dicendo che, secondo Foucault, il neoliberalismo sarebbe un’arte di governo che cede sul piano della disciplina che investe i corpi individuali per agire piuttosto sull’ambiente in cui « giocano » gli individui, modificandone le variabili. L’homo œconomicus teorizzato dai campioni del neoliberalismo americano è colui che risponde in modo sistematico alle modificazioni introdotte nell’ambiente : per governarlo non resta che lasciarlo fare, lasciarlo giocare, e intervenire sugli ambienti in cui si muove. Immagini una specie di governo indiretto e a distanza, che non può toccare gli individui se non per il tramite di un ambiente minuziosamente regolato, e immagini di essere libero, tu stesso, come un pezzo degli scacchi in una partita in stallo. Ma anche queste realtà ambientali, come i modelli antropologici liberali, non sono nulla di naturale – ti dici. Gli ambienti vanno creati, inventati e portati a un livello di realtà tale da poter funzionare come media di governo – sussurri nella tua aula immaginaria. Foucault le chiama « realtà di transazione », queste realtà ambientali che servono a governare, questi « correlati » della governamentalità – e te li immagini come degli oggetti, dei punti di presa, diafani e spettrali nella consistenza, solidissimi e reali negli effetti –, come la « società civile », la « sessualità », la « follia », dice Foucault. All’improvviso ti ritrovi in un mondo in cui i corpi sono mossi senza sosta da enti disincarnati che pure hanno la forza di dirigere le condotte, di muovere i gesti, di regolare i comportamenti, a cominciare dalla realtà di transazione più antica, l’anima – « prigione del corpo », vecchia storia –, fino a quelle più moderne e contemporanee : mercato, mercato del lavoro, economia della conoscenza, meritocrazia – pensi. Immagini di vivere in un mondo in cui la valutazione è dappertutto, perché la valutazione – ti dici – è una tecnologia ambientale di governo, un modo di « organizzare la libertà » – scrive Valeria Pinto. A partire dall’esperienza della valutazione, ti ritrovi intrappolato nel paradosso che Foucault pone al cuore della governamentalità liberale : governare attraverso la libertà, attraverso la produzione e il consumo di libertà. Immagina di vedere sfumare le distinzioni fra libertà e obbedienza, di vedere confondersi le frontiere fra « assoggettamento » e « soggettivazione », di averne persino abbastanza di queste fruste parole filosofiche. Allora precipiti al suolo di quello che stai facendo qui e ora e ti ritrovi bruscamente nel piccolo mondo di valutazioni accademiche in cui passi le mattinate. Immagina di esaminare con grande solerzia la funzione che ogni nodo, in questa trama di valutazioni, esercita rispetto ai comportamenti, ai gesti, alle condotte, alle forme di vita che riguardano te e i tuoi « simili ». Non cerchi dei rapporti di causa ed effetto fra pratiche di valutazione e formazione della mentalità di ogni individuo, cerchi piuttosto qualcosa come una combinatoria da descrivere ex post, a partire dai suoi effetti. Cerchi di farti un’immagine, pur piccola e tascabile, dell’operatività concreta di una tecnologia ambientale di governo. Provi ad abbozzare una mappa delle pratiche di autoregolazione di sé all’epoca della valutazione di tutti e di ciascuno, dentro l’economia della conoscenza, per vedere come un ambiente strutturato dalle pratiche di valutazione produca e organizzi la libertà degli individui che vi sono coinvolti. Pensi alla valutazione dei candidati all’Abilitazione scientifica nazionale, in Italia, pensi alle « mediane », alla classificazione delle riviste scientifiche, ai giudizi espressi dalle commissioni su ogni candidato e visibili in rete, e incroci tutto questo con le procedure di knowledge assessment che governano l’economia della conoscenza a partire dalle istituzioni europee. Ti fai un’immagine della figura di studioso che le pratiche di valutazione – le loro attese e i loro esiti – disegnano, e così ti immagini una figura, o meglio, un « profilo » che è quello di uno strenuo produttore di pubblicazioni scientifiche valutabili – e ti ritornano in mente le mail che hai ricevuto all’epoca della prima tornata di abilitazioni da parte di sedicenti editori scientifici : « gentile ricercatore, ci consegni il suo manoscritto in formato Word, entro pochi giorni andremo in stampa… », oppure ti ricordi di esserti imbattuto pure nell’arte di spezzare libri già pubblicati in una serie di altri libri che non andranno mai in commercio ma che, in quanto dotati di codice isbn, saranno comunque conteggiabili come pubblicazioni distinte. Un « doping di pubblicazioni », leggi nel libro di Valeria Pinto. Libri, articoli, saggi che difficilmente qualcuno leggerà, forse nemmeno i valutatori. Ti chiedi che ne è oggi dell’idea di « pubblico » e della sua relazione con il gesto della scrittura. Chi scrive, per chi lo fa ? Ti chiedi anche quali effetti produca sul piano della scrittura e dei suoi stili, dei suoi generi, delle sue forme questa corsa forsennata verso la solidificazione di ogni discorso teorico, critico, politico in oggetti scientifici valutabili, ti chiedi se resti qualcosa dell’elemento estetico della scrittura, come dei suoi inciampi, dei suoi paradossi, delle trasformazioni e degli abissi che essa impone al lavoro del pensiero. Immagini ancora quella figura di studioso – quel profilo – e vedi una silhouette dai contorni definiti, percepisci persino in te stesso il desiderio di coincidere con quella silhouette netta, chiara, piena compatta, coerente in tutte le sue parti : ogni eventuale elemento di « schizofrenia », o anche solo di eclettismo, è un evidente segno di immaturità scientifica. E poi pensi alle pratiche che l’autocostruzione di un profilo scientifico spendibile nel mercato della valutazione favorisce e sollecita. Ti ricordi una tua collega francese – stanca, estenuata – che una volta ti ha raccontato la sua vita da « Robin Hood » alla rovescia : « quando voglio organizzare un convegno internazionale – ti diceva – fisso una quota di partecipazione per i ricercatori giovani e sconosciuti, quelli che non contano nulla e che devono farsi un nome e una visibilità, e con i soldi che ricevo da loro pago le spese e i compensi per i keynote speakers, quelli importanti, con i quali devo tessere relazioni e fare “campagna elettorale” », « oppure – continuava –, se devo curare l’edizione inglese di un volume collettivo, in modo da aggiungere una riga “pesante” al mio cv, ma mi mancano i soldi per le traduzioni dei testi, allora faccio una call for translation e sfrutto il lavoro gratuito di chi ha bisogno di alimentare il proprio curriculum con una traduzione ». Immagini di vivere in un mondo in cui la valutazione è dappertutto, e immagini che questo mondo sia popolato da « asceti della performance » – come dice uno studioso di management francese – e da micro-sfruttatori del lavoro altrui, e vedi bene, nella tua immaginazione, come queste figure si confondano nei medesimi individui, transitino continuamente attraverso di loro, e costituiscano la variante intellettuale della libera impresa di sé al tempo della valutazione come tecnologia di governo. Pensi che molto si possa dire delle figure antropologiche che ti stai immaginando ma non che siano figure dell’obbligo o della coercizione, e nemmeno della servitù volontaria : nessuno è obbligato a fare quello che fa, in questo piccolo mondo libero e in overdose di pubblicazioni, saturo di discorso e punteggiato da continue prese di parola. Allora immagini altre mosse, perché capisci che per rendere inoffensivo il discorso esiste la censura ma esiste anche la sua proliferazione infinita ancorché disciplinata, come un continuo, sordo, ordinato brusio, e immagini di creare zone di silenzio e di ascolto come se fossero pratiche di sciopero, pensi a quel « divenire impercettibile » di cui parlavano Gilles Deleuze e Felix Guattari e di cui solo ora ti sembra di iniziare a capire qualcosa, immagini che quel « coraggio della verità » di cui ci si è riempiti la bocca nel tuo ambiente in questi ultimi anni possa avere a che fare più con una messa in sospensione del discorso che con l’ennesima presa di parola, ma hai già immaginato troppo, e la tua mattinata ormai è finita.
Immagina che ora sia pomeriggio, cioè la parte della giornata in cui devi cercare un lavoro che ti dia un salario, una fonte di reddito. Ti sei iscritto al collocamento, non ti hanno aiutato. Però ti hanno proposto di frequentare un atelier sulla creazione di impresa. Immagina di esserci andato : hai trovato consulenti seri e molto motivati, pronti ad accompagnarti nel tuo percorso imprenditoriale. Solo che tu non hai un progetto, lo devi ancora immaginare. Ti hanno riempito di informazioni, hai scoperto che in Francia esiste lo statuto di auto-imprenditore, che non è come la Partita Iva italiana, è una posizione che puoi aprire immediatamente in rete, è attiva da subito, se lavori, allora fatturi e paghi le tasse, se non lavori, non fatturi e non le paghi. Se non funziona, come l’hai aperta così la puoi chiudere. Quelli del collocamento ne sono entusiasti, consigliano a tutti di diventare auto-entrepreneurs. Immagina che proprio il giorno dopo una delle scuole di lingue alle quali ti sei proposto come insegnante di italiano ti risponderà – sarà l’unica a farlo – chiedendoti se sei disponibile ad assumere lo statuto di auto-imprenditore per l’insegnamento dell’italiano. Todos caballeros, ovvero tutti imprenditori – ti dirai. Ma non ti stupisci, perché conosci bene quel libro là, quello di Foucault, il corso al Collège de France del 1979, sempre quello. È quel libro che ti ha insegnato che lo sforzo utopico neoliberale coincide con la trasformazione della società in una società di unità-imprese, con la « demoltiplicazione » della forma-impresa come forma della soggettività. È stato quel libro, insieme a tutta una letteratura che si è sviluppata a partire da lì, a spiegarti che l’onnipresenza della formula « capitale umano » – mirabile invenzione della Scuola di Chicago – nel discorso pubblico, politico, economico significa « ognuno imprenditore di se stesso », ognuno impegnato a valorizzare quel capitale costituito dall’insieme delle proprie capacità, competenze, attitudini fisiche e psicologiche. Se la materia di cui è fatta la vita – immagini – deve essere gestita come capitale, quale forma deve assumere quella vita – la tua –, se non la forma dell’impresa ? Che l’impresa sia un’altra realtà di transazione – astratta, ineffabile, concretissima ? Ti viene da ridere, perché immagini di vedere ovunque realtà di transazione e superfici di attacco per una e ti chiedi a quale livello di paranoia tu stia arrivando. Però – pensi –, Foucault ci ha insegnato, attraverso libri comeSorvegliare e punire e corsi al Collège de France come Il potere psichiatrico, che la posta in gioco del potere disciplinare, del potere che si esercita sulla vita, è di produrre un’anima intorno al corpo, di dare forma di anima – un’anima visibile e « autentica » – a un corpo ; un corpo che di per sé non è certo bruta sostanza biologica, passività in attesa di impressione, ma « corpo utopico », visibile e invisibile, aperto e chiuso, misterioso e trasparente, fucina permanente di forme possibili, fame e sete di soggettivazioni – ecco stai di nuovo immaginando di fare una lezioncina. Allora immagini di chiederti : come si fa a trasformare una vita in capitale umano ? E immagini di risponderti : modellando quella realtà di transazione che si chiama anima – la nietzschiana prigione del corpo – sulla forma dell’impresa. E come si fa ? – ti chiedi ancora. E che cosa c’entra la valutazione come tecnologia di governo ? Immagina di trovare la risposta in quello che stai facendo questo pomeriggio per cercare lavoro : curriculum e lettera di motivazione, curriculum e lettera di motivazione, curriculum e lettera di motivazione. Immagina di scrivere e riscrivere molte versioni del tuo curriculum e altrettante – anzi, ben di più – lettere di motivazione : dipende dal destinatario della tua candidatura, da chi valuterà il tuo dossier, dal tipo di impiego che stai « postulando », per usare un calco del termine francese che si usa per indicare la richiesta di lavoro e che trasmette molto bene la disposizione d’animo del demandeur d’emploi. Antica invenzione, il curriculum vitae. Ti sembra di aver letto che risalga alla fine dell’ottocento, che sia una pratica nata in ambito militare, come quasi sempre accade per le procedure di reclutamento e assunzione. Immagini però che tuo padre e tua madre non abbiano mai scritto un curriculum in vita loro, o forse una volta appena in tutta la loro esistenza di lavoratori attivi, e immagini bene. Invece tu, che speri di non essere nemmeno alla metà della tua vita, ne hai già scritti, diffusi e fatti esaminare a centinaia, forse se li sommi tutti superi il migliaio, e per un momento ti immagini come una stramba creatura ibrida, a metà fra la macchina e il vivente, che continuamente si sdoppia, si osserva, si contempla, si sorveglia, si governa – e fin qui tutto normale, pensi, è il movimento della coscienza, è il gioco delle istanze psichiche, è la condanna alla trascendenza dell’« animale che parla » –, e che però iscrive tutto questo nella struttura di un curriculum ; come le stampanti di una volta, quelle che vomitavano fogli infiniti e traforati, così tu non smetti di srotolare davanti a te stesso la tua vita, i tuoi gesti, le tue scelte, in forma di cv. Ti domandi se la tua immaginazione non stia esagerando, e ti rispondi chiedendoti quante volte, nella tua vita, tu abbia regolato le tue esperienze e le tue scelte in base alla loro pertinenza a un curriculum e alla loro capacità di aggiungervi una riga, quante volte tu abbia consegnato a quel curriculum, o alla sua idea, al suo fantasma, il potere di decidere sulla tua esistenza. Immagina che siano state tante, eppure troppo poche, infatti ne paghi le conseguenze, infatti, per l’ennesima volta, stai « postulando » un lavoro. Immagina di mentire almeno un po’, sia quando redigi il tuo curriculum, sia quando, attraverso la lettera di motivazione, lo spieghi, lo giustifichi, lo compatti, ne riempi i buchi. Immagina di non riuscire a coincidere con l’immagine vetrificata che dai di te stesso, di sfalsarla, ma pure di inseguirla, quell’immagine, e quel senso di coerenza, di pienezza, di lucidità che ne tiene insieme gli elementi, come se tu fossi sempre in ritardo sulla tua vita (sbirci la pila dei tuoi libri : comme si tu étais en retard sur la vie – ti suggerisce maliziosamente il dorso di un libricino di René Char). Immagina di inseguire quell’immagine come si insegue l’illusione dello specchio, con la sua capacità di solidificazione immaginaria, di « richiudere su di sé e nascondere per un momento l’utopia profonda e sovrana del nostro corpo », come ha detto una volta Foucault in una conferenza radiofonica del 1966. Il curriculum, specchio dell’anima. Per quanto tu menta, per quanto tu sia votato a una filosofica malafede, per quanto tu faccia professione di ironica distanza rispetto ai tuoi stessi sforzi di renderti oggetto appetibile sul mercato dei lavori, tu sai bene quanto sia importante modellizzare la tua storia all’interno di un profilo specifico, coerente, lineare, progressivo, disciplinato – e questo ti riporta, peraltro, alle pratiche di valutazione accademiche di questa mattina –, e perciò lo fai, e temi sempre di non farlo abbastanza. Pensi che bisognerà studiare, prima o poi, questo « gioco di verità » su di sé che si chiama curriculum vitae, e gli effetti collaterali di soggetto che si producono all’interno del gesto, continuamente rilanciato, di scrittura e riscrittura dell’immagine di sé. Intanto, immagini di vivere in un mondo in cui la (auto)valutazione è dappertutto. E, d’altronde, ti rendi conto che le pratiche di autovalutazione e autogoverno finalizzate all’accaparramento di una risorsa scarsa (il lavoro/reddito) in un mercato iper-competitivo sono codificate, istituite e validate all’interno delle stesse organizzazioni aziendali presso le quali ti candidi. Immagina, nfatti, di aver letto qualche manuale di management delle risorse umane, per provare a entrare nel mondo in cui vive chi ti valuta, oppure immagina di aver lavorato in quell’ambito, o nel campo della formazione continua, quella finanziata dalle istituzioni europee, quella che ha per obiettivo, come si dice in tutti i documenti ufficiali, la valorizzazione e lo sviluppo del capitale umano. Del resto, hai una formazione umanistica e se vuoi lavorare in un’azienda non puoi che entrare dalla porta delle risorse umane, come tutti i luoghi comuni sulla « occupabilità » degli « umanisti » ti insegnano. Questi manuali, queste esperienze, ti ripetono che il mondo è cambiato, il lavoro si è trasformato, e il bel mondo di Brecht, come diceva già Pasolini, non esiste più. Oh, che novità – ti dici : è da quando andavi a scuola che senti cantare la canzone della globalizzazione e della flessibilità, quella che annuncia che il conflitto non è più fra capitale e lavoro ma fra chi ha il coraggio di cavalcare la tigre del cambiamento e i rottami reazionari che vi si oppongono. In questo mondo nuovo – hai scoperto – i contratti giuridici che regolano i rapporti di lavoro sono inutili orpelli che irrigidiscono e appesantiscono le organizzazioni, che invece devono essere snelle e duttili, in grado di vibrare come un’ancia al soffio irregolare dei mercati. Un altro tipo di normatività deve intervenire a regolare il rapporto di lavoro – pardon, pensi : di collaborazione –, una normatività di tipo psicologico. Si dice « contratto psicologico », infatti, e si intende uno scambio di promesse che nel contratto giuridico non si può scrivere, o non si può scrivere del tutto. Questo è ciò che hai imparato. Ieri, il contratto psicologico era fatto di assoggettamento contro salario, di dedizione in cambio di impiego stabile ; oggi, è fatto di motivazione, implicazione, identificazione con l’impresa all’interno di un rapporto di lavoro volatile come un gas. Capitale e lavoro : immagini il due che diventa uno, e non certo perché la solida fatica del lavoro subordinato e comandato si disperda finalmente in una società di produttori liberi e indipendenti, ma perché – immagini – ciascuno diviene particella imperfetta che partecipa di una quasi-platonica idea imprenditoriale, ciascuno docile fibra di quell’universo che si chiama impresa. « Identificazione organizzativa » : immagina di aver appreso che questa nozione è una nozione decisiva nelle pratiche manageriali contemporanee. È l’identificazione con l’impresa che spinge le persone verso una postura proattiva e auto-imprenditoriale, che promuove il « commitment » e favorisce la stipula del contratto psicologico, in aziende in cui i subordinati sono collaboratori, la parola « controllo » si accompagna costantemente al prefisso « auto », e le persone devono fare appello alla propria personalità, più che alla gerarchia aziendale, per raggiungere gli obiettivi dell’organizzazione – come hai letto in un libro di management dedicato proprio all’identificazione organizzativa. Immagina di chiederti quanto tutto questo ti riguardi, o riguardi piuttosto un ristretto mondo di « quadri », immagina di chiederti quanto questi discorsi girino a vuoto su loro stessi o quanto trapassino in ciò che i filosofi chiamavano Zeitgeist, lo spirito del tempo. Immagina di ricordarti di quando lavoravi nella formazione continua e ti trovavi a organizzare corsi obbligatori di comunicazione e team working, gestione dello stress, creazione di impresa, tecniche di leadership ecc. per apprendisti commessi, tornitori, fresatori, addetti alle macchine a controllo numerico, elettricisti, idraulici ecc. ; immagina di ricordarti di quando, tempo fa, hai fatto un colloquio di gruppo per un posto di commesso in un supermercato e hai partecipato a un role playing in cui si trattava di decidere tutti insieme, attraverso un brain storming, quali sono le dieci qualità che definiscono un autentico leader al giorno d’oggi ; immagina di ricordarti che, colto alla sprovvista, hai fatto scena muta e infatti non hai avuto il posto ; immagina di prendere atto che il linguaggio manageriale di cui hai fatto esperienza nei libri sia lo stesso linguaggio che ritrovi nei documenti del Fondo Sociale Europeo e nella maggior parte del discorso politico che riguarda il lavoro, la scuola e l’università ; immagina di pensare che il confine fra le pratiche manageriali e ciò che dovrebbe stare loro di fronte, accanto o altrove sia un confine mobile e poroso, che forse non esiste nemmeno, e immagina di ipotizzare che gli stessi discorsi manageriali non siano altro che la codificazione momentanea di una tecnica di governo che, dal basso, li eccede, li sostiene e li fa funzionare. E siccome stai immaginando di vivere in un mondo in cui la valutazione è dappertutto, ti ricordi pure di aver letto nella letteratura manageriale che le pratiche di valutazione del lavoro, della performance, del potenziale della risorsa umana, hanno a che fare con la costruzione dell’« immagine di sé » – proprio così, dell’immagine di sé –, con la rappresentazione della propria personalità, della propria identità e del proprio ruolo sociale. Uno psicologo del lavoro francese, che si chiama Claude Lévy-Leboyer, ti ha insegnato che la costruzione dell’immagine di sé è la vera posta in gioco delle pratiche di valutazione del lavoro : ciò che consente alla risorsa umana di conoscere se stessa, di soddisfare l’« appetito di sapere » che la concerne, di accrescere la lucidità, la qualità e la pertinenza della propria immagine per potersi infine manifestare a se stessa, e per potersi trasformare, sviluppare, potenziare. Contemporaneamente, la valutazione delle risorse umane fornisce all’azienda una descrizione esatta dell’individuo, ne bracca la « verità », ne verifica la compatibilità con l’organizzazione, ne mappa il « potenziale umano » e traccia le linee del suo possibile sviluppo, consente di prevederne i comportamenti. Impari che la costruzione dell’immagine di sé è un elemento di quel contratto psicologico che sigla la corrispondenza di amorosi sensi fra l’individuo e l’impresa, è un elemento della retribuzione, a volte l’elemento principale, talora l’unico : lavora per me e ti dirò che sei. E ciò che puoi diventare. Ti chiedi quale forma prenda questa ennesima declinazione del « supplemento d’anima » che l’immagine di sé – come uno specchio – è in grado di secernere, e ti rendi conto che tutto ruota intorno al concetto di « competenza ». Immagini la tua stessa immagine – ciò che rincorri dal mattino al pomeriggio mentre insegui un lavoro – ed essa ti appare come una cartografia delle tue competenze, trasparente e accessibile alla coscienza, in grado di potenziare ciò che in una certa psicologia si chiama « autoefficacia ». Immagini te stesso come una costellazione di competenze che occorre conoscere, aggiornare, valorizzare, sviluppare, e sulle quali occorre investire. Le competenze : l’unica cosa che puoi diagnosticare e cambiare, quando la personalità resiste indefessa ai cambiamenti e l’inconscio – posto che tu ne abbia uno – sfugge per definizione al controllo del soggetto sovrano che vorresti essere. Le competenze : l’unica cosa che puoi gestire come se tu fossi il manager di te stesso. Stai cominciando a capire come, attraverso l’autentificazione di sé in quanto aggregato di competenze valutabili e traducibili in curriculum, si trasforma una vita – la tua – in capitale umano. Il curriculum, specchio dell’anima che si fa impresa.
È quasi sera, il tuo pomeriggio di ricerca di lavoro ormai è finito. Immagina di spegnere il computer con gli occhi lucidi di stanchezza, anche se non hai fatto nulla fuorché immaginare. Hai capito che la valutazione è quella tecnica di governo che tiene insieme le tue mattine e i tuoi pomeriggi, perché essa organizza – materiale e incorporea – gli ambienti in cui ti muovi, perché essa è il necessario strumento di misurazione del valore del tuo capitale umano e della remunerazione dei tuoi investimenti su di esso, perché essa ha a che fare con quelle scabrose questioni che riguardano l’identità, la soggettivazione, il riconoscimento, il narcisismo – chiamale come vuoi –, con la produzione di una vera immagine di sé. Hai capito che questa immagine è valore d’uso e valore di scambio nel mercato, posta in gioco di una micropolitica che investe i tuoi gesti quotidiani, punto di arrivo irraggiungibile di una teoria di esercizi che assomiglia a una weberiana ascesi intramondana, che assomiglia, tutto sommato, a qualcosa come una disciplina – uscita dalla porta, rientrata dalla finestra. Ti viene voglia di continuare e approfondire i tuoi studi, collegare le pratiche della valutazione alle analisi di Foucault sul potere pastorale e sulla confessione come dispositivo di soggettivazione, metterti anche tu a cercare la genealogia del management nelle tecniche cristiane di governo delle anime – tanto più che, prima di spegnere il computer, hai visto su internet che la Pontificia Università Lateranense, « nel solco dell’insegnamento di Papa Francesco », organizza il primo corso di « Management pastorale », finalizzato a « ottimizzare le risorse umane ed economiche, coniugando competenza e Vangelo » : il management, figliol prodigo, è tornato a casa. Ma alla fine non lo farai, penserai che non hai più tempo, anzi, che è tempo di disperdere questo sapere nelle pratiche di vita – le tue –, per cambiarle, per farle diventare loquaci, prima che esse divorzino per sempre dai bei discorsi ; penserai che al pessimismo della ragione – come diceva Franco Basaglia parafrasando Gramsci – si deve accoppiare l’ottimismo delle pratiche, perché tu non sei esterno al mondo della valutazione, e non ne uscirai fuori grazie a un balzo del discorso, e perché tu non sei una vittima : anche tu, come tutti, sei un uomo che valuta.
 Imagine vivre dans un monde où l’évaluation est partout. Tu es dans une ville européenne, mais tu pourrais être aussi aux États-Unis, l’important est que tu sois quelque part en Occident, dans un état soi-disant libéral, et que tu sois là pendant ces années, pendant ces jours. Imagine être en Italie, à Milan, à Rome, ou bien – pourquoi pas ? – à Trieste. Mais tu pourrais être aussi en France, imagine, par exemple, d’être à Paris. Tu es l’un des très nombreux Italiens qui habitent à Paris, qui cherchent du boulot, qui trouvent un boulot, qui perdent leur boulot. Peut-être, es-tu un soi-disant travailleur cognitif – statut qu’on n’arrive jamais à bien définir, et pourtant tout le monde sait ce que c’est –, tu as bien fait une thèse, même deux – en fait, non, ce n’est pas ton cas –, par contre tu as fait plusieurs postdocs. Imagine-toi te réveiller le matin dans ton appartement et diviser ta journée en deux parties : le matin, tu étudies et tu écris pour attraper une autre bourse de recherche, l’après-midi, tu cherches un travail quelconque, sans savoir exactement lequel, peut-être un boulot alimentaire – on dit comme ça, en France –, un travail pour gagner ta vie, ou non, peut-être tu cherches le travail de ta vie, tu cherches l’occasion de la changer, ta vie. En tout cas, imagine vivre dans un monde où l’évaluation est partout.
Imagine vivre dans un monde où l’évaluation est partout. Tu es dans une ville européenne, mais tu pourrais être aussi aux États-Unis, l’important est que tu sois quelque part en Occident, dans un état soi-disant libéral, et que tu sois là pendant ces années, pendant ces jours. Imagine être en Italie, à Milan, à Rome, ou bien – pourquoi pas ? – à Trieste. Mais tu pourrais être aussi en France, imagine, par exemple, d’être à Paris. Tu es l’un des très nombreux Italiens qui habitent à Paris, qui cherchent du boulot, qui trouvent un boulot, qui perdent leur boulot. Peut-être, es-tu un soi-disant travailleur cognitif – statut qu’on n’arrive jamais à bien définir, et pourtant tout le monde sait ce que c’est –, tu as bien fait une thèse, même deux – en fait, non, ce n’est pas ton cas –, par contre tu as fait plusieurs postdocs. Imagine-toi te réveiller le matin dans ton appartement et diviser ta journée en deux parties : le matin, tu étudies et tu écris pour attraper une autre bourse de recherche, l’après-midi, tu cherches un travail quelconque, sans savoir exactement lequel, peut-être un boulot alimentaire – on dit comme ça, en France –, un travail pour gagner ta vie, ou non, peut-être tu cherches le travail de ta vie, tu cherches l’occasion de la changer, ta vie. En tout cas, imagine vivre dans un monde où l’évaluation est partout.Oui, car le matin, quand tu étudies et tu écris pour trouver une bourse de recherche, tu as constamment affaire aux procédures d’évaluation qui sont censées apprécier, trier, discriminer, classer, différencier, sélectionner, hiérarchiser et finalement retenir ces projets. Procédures, mécanismes, machines, dispositifs, outils, apparats, processus, systèmes, méthodes, normes – tu penses. Tu sais d’ailleurs que le dossier que tu as envoyé pour postuler à cette bourse est le numéro trois mille cinq cent etc., tu sais que chaque dossier comporte deux lettres de recommandation écrites par des scientifiques renommés, décriant les qualités excellentes, extraordinaires, absolument remarquables du candidat, tu sais qu’à trois mille cinq cent etc. projets – mais peut-être qu’ils sont moins nombreux, peut-être que pas tous ceux qui ont démarré la procédure en ligne pour postuler que pas tous ceux qui ont démarré la procédure en ligne pour postuler et qui ont reçu un numéro de dossier ont mené à terme la demande, imaginons qu’ils soient moins de la moitié, c’est-à-dire mille cinq cent etc. –, donc tu sais qu’à mille cinq cent etc. projets correspondent trois mille lettres de recommandation. Tu comprends qu’il existe une sorte de production à l’échelle industrielle de ce genre de lettres, et tu supposes qu’il y a des scientifiques renommés qui passent une bonne partie de leur temps, lorsque la date limite pour postuler une bourse de recherche se rapproche, à écrire des lettres de recommandation pour quelqu’un qu’ils ne connaissent peut-être qu’à peine. Tu penses même monter une entreprise de production de lettres de recommandation en sous-traitance, tu en ris et tu décales ce drôle de projet pour la deuxième partie de ta journée, celle où tu te consacres à la recherche d’un emploi. Imagine toi bien connaître les procédures, les dispositifs, les protocoles d’évaluation des projets, parce que, toi-même, dans ta petite expérience, tu as été chargé d’évaluer, et du coup tu sais bien ce que signifie une évaluation formalisée à travers un processus de double-blind peer review. Tu te demandes comment ils font pour gérer l’évaluation d’une telle quantité de projets en si peu de temps, le niveau moyen des projets étant très élevé – cela aussi tu le sais bien –, et tu te réponds à toi même que, sans une machine informatique capable de gérer en même temps l’aspect objectif et subjectif de l’évaluation, ce seront la chance et les rapports de force académiques qui trancheront. Tu comprends que les bourses que tu as obtenues jusqu’ici, tu les as obtenues grâce à l’horrible et immoral hasard – la chance de tomber sur un referee favorable, par exemple –, et pas vraiment parce qu’un jeu d’évaluations croisées aurait enfin rendu justice à ton mérite. Imagine toi t’interroger sur les raisons de cet effort démesuré d’évaluation et de ce gigantisme bureaucratique, en n’oubliant jamais que le hasard, le par-delà le bien et le mal que la bonne évaluation devrait chasser, finit toujours par revenir par la fenêtre. Tu te souviens d’avoir lu un livre de Béatrice Hibou intitulé La bureaucratisation du monde à l’ère néolibérale, qui t’a appris combien et comment la bureaucratisation de la politique, de l’administration publique et de la vie quotidienne ne sont que le reflet d’une gouvernementalité néolibérale, et du coup tu ne peux pas t’arrêter d’énumérer, dans un catalogue borgésien infini, toutes les pratiques bureaucratiques et d’évaluation qui te concernent à ce moment précis : tu t’es inscrit au pôle emploi, tu as demandé le RSA, tu cherches un appartement à louer, tu dois renouveler la carte de la Bibliothèque Nationale de France, tu as ouvert un compte bancaire, tu as demandé ta carte vitale, tu as envoyé un article à une revue de philosophie, tu as postulé des bourses de recherche ainsi que plusieurs offres d’emploi – pour chacune de ces activités il t’a fallu monter un dossier assez nourri et suffisamment robuste pour une évaluation très attentive. Toutes ces pratiques, prises individuellement, sont nécessaires, convenables, presque évidentes, aucun doute ! – tu penses –, mais tout à coup tu les vois comme un ensemble, tu les imagines comme un complexe qui ne manque pas d’une involontaire cohérence. Sans compter le nombre de questionnaires d’évaluation que tu remplis quand tu profites d’un service internet ou téléphonique, et aussitôt tu te souviens également des questionnaires de satisfaction que tu distribuais aux étudiants à l’université, de ceux que tu as remplis quand toi-même tu étais étudiant, des interminables questionnaires d’évaluation que tu gérais quand tu travaillais en entreprise et tu galérais avec son système qualité ISO quelque chose. Tu te souviens de ce qu’il en était finalement de ces questionnaires, tu te souviens des arrangements, des petits stratagèmes afin d’ajuster les choses, d’esquiver les problèmes, d’accomplir les obligations du système. Tu te souviens des statistiques qui en étaient tirées, et de leur usage de propagande. Tu te souviens également d’avoir lu, une fois, un manuel de management consacré aux pratiques d’évaluation du travail, un ouvrage collectif, et tu te souviens que l’un des auteurs, dans un élan de franchise, avouait que ces pratiques se révélaient, au fond, inefficaces par rapport a l’objectif même qu’elles se donnaient. Et pourtant – il disait –, il faut les mettre en place, puisqu’elles contribuent à créer un climat de justice organisationnelle, sans lequel, aujourd’hui, il n’est pas possible de motiver les gens. Donc, tu repenses au livre de Béatrice Hibou sur la bureaucratisation du monde et tu constates que cela résonne avec ton expérience quotidienne. Tu comprends qu’évaluation et bureaucratie ne sont que deux miroirs opposés et que lorsque l’on affirme la nécessité de démanteler les molochs bureaucratiques du passé, de la science de l’administration du 20e siècle, au nom de la flexibilité, bien sûr, du nivellement des hiérarchies, de l’empowerment, de la « proactivité », de la prise d’initiative individuelle, de la responsabilité, de la créativité, c’est à ce moment là qu’un nouveau système (post)bureaucratique va se dessiner comme arrière-plan de ces discours, et « évaluation » est le nom qui leur correspond le mieux. Tu imagines vivre dans un monde où l’évaluation est partout. Ensuite, tu te souviens que tu as étudié la pensée de Michel Foucault, et qu’en Italie il vient de paraître un livre sur la culture de l’évaluation qui s’intitule, justement, Valutare e punire – évaluer et punir –, dont l’auteur s’appelle Valeria Pinto. Imagine-toi te procurer ce bouquin, tu sais qu’un ami italien l’a, il te le prête, voilà, imagine que tu l’as déjà lu. Grâce à ce livre, tu découvres toute une littérature critique au sujet de l’évaluation que tu ne connaissais pas, et qui te parle d’audit society ou evaluative society, d’inspection age, qui te parle de l’évaluation comme technologie de gouvernement, comme mode d’existence d’un état néolibéral. Du coup, tu vas revoir un livre de Foucault qui s’intitule Naissance de la biopolitique, imagine le récupérer parmi les livres empilés sur ton bureau et retrouver tout de suite les pages qui t’intéressent, des pages qu’à l’époque tu avais bien notées et soulignées, des pages que, maintenant, tu lis avec une certaine agitation. Imagine d’imaginer expliquer à un public ce que tu es en train de lire, comme si tu étais dans une salle de cours, parce que c’est ce que tu fais toujours quand tu essaies de fixer des concepts ou de les expliquer à toi-même. Et comme ça, tu imagines, sans même t’en rendre compte, de donner un cours où tu résumes quelques aspects des analyses du néolibéralisme menées par Foucault dans Naissance de la biopolitique, qui est d’ailleurs le cours donné au Collège de France en 1979. « Vous voyez – tu te retrouves à chuchoter dans une salle de cours imaginaire –, Foucault, en 1979, poursuit sa recherche autour de la rationalité de gouvernement libéral et néolibéral en tant que cadre d’intelligibilité de la biopolitique, en insistant, une fois de plus, sur le déclin des technologies disciplinaires comme chiffre et forme hégémonique de l’exercice du pouvoir dans les sociétés occidentales. La gouvernementalité d’aujourd’hui, et peut-être celle à venir aussi, s’effectue surtout en tant que ‘technologie environnementale’ opérant autour des individus, au niveau des règles du jeu, tout en reculant par rapport à la ‘technologie humaine’ des systèmes normatifs-disciplinaires ». Tu es en train de dire que, selon Foucault, le néolibéralisme serait un art de gouvernement qui cède par rapport à la disciplinarisation des corps individuels pour agir plutôt sur l’environnement où les individus « jouent », en modifiant leurs variables. L’homo œconomicus théorisé par les maîtres à penser du néolibéralisme américain est celui qui répond systématiquement aux changements provoqués dans son environnement : pour le gouverner, il ne reste qu’à le laisser faire, le laisser jouer, en intervenant sur les environnements où il vit. Tu imagines une espèce de gouvernement indirect et à distance, qui ne peut pas toucher les individus qu’à travers un environnement minutieusement réglé, et tu imagines que toi-même, tu es libre comme une pièce d’échec dans une partie nulle. Mais ces réalités environnementales, ainsi que les modèles anthropologiques libéraux, ne sont en rien naturelles. Les environnements, il faut les créer, les inventer et les ramener à un niveau de réalité tel qu’ils puissent fonctionner comme média de gouvernement – chuchotes-tu dans ta salle de cours imaginaire. Foucault les appelle « réalités de transaction », ces réalités qui servent à gouverner, ces « corrélatifs » de la gouvernementalité – et tu les imagines comme des objets, des points de prise, diaphanes et spectraux dans leur texture, très solides et réels dans leurs effets –, comme, par exemple, la « société civile », la « sexualité », la « folie », dit Foucault. Tout à coup, tu te retrouves dans un monde où les corps sont poussés sans cesse par des êtres désincarnés qui pourtant ont la force de diriger les conduites, de remuer les gestes, de régler les comportements : à partir de la réalité de transaction la plus ancienne, l’âme – « prison du corps », vieille histoire –, jusqu’à celles les plus modernes : marché, marché du travail, économie de la connaissance, méritocratie – penses-tu. Imagine toi vivre dans un monde où l’évaluation est partout, car l’évaluation – te dis-tu –, c’est une technologie environnementale de gouvernement, une façon d’organiser la liberté, comme l’écrit Valeria Pinto. À partir de l’expérience de l’évaluation, tu te retrouves coincé à l’intérieur du paradoxe que Foucault place au cœur de la gouvernementalité libérale : gouverner à travers la liberté, par la production et la consommation de liberté. Imagine toi voir s’évanouir les distinctions entre liberté et obéissance ainsi que les frontières entre « assujettissement » et « subjectivation », et d’en avoir même marre de ces mots philosophiques épuisés. Du coup, tu reviens brusquement à ce que tu fais ici et maintenant, et soudain tu te retrouves dans le petit monde d’évaluations académiques où tu passes tes matinées. Imagine toi examiner, avec le plus grand zèle, la fonction que chaque nœud exerce – dans cette trame d’évaluations – par rapport aux comportements, aux gestes, aux conduites, aux formes de vie concernant toi-même et tes « semblables ». Tu ne cherches pas des rapports de cause à effet entre pratiques d’évaluation et formation des mentalités des individus, tu cherches plutôt quelque chose comme une combinatoire à décrire après-coup, à partir de ses effets. Tu cherches à te fabriquer une petite image de poche du fonctionnement concret d’une technologie environnementale de gouvernement. Tu essaies d’esquisser une carte des pratiques d’autorégulation de soi à l’âge de l’évaluation de tous et de chacun, à l’intérieur de l’économie de la connaissance, pour voir comment un environnement façonné par des pratiques d’évaluation produit et organise la liberté des individus impliqués. Tu penses aux pratiques d’évaluation des candidats à la qualification comme professeur universitaire en Italie (« l’Abilitazione Scientifica Nazionale »), aux « mediane », les lignes médianes qui établissent le nombre minimum de publications, au classement des revues scientifiques, aux rapports d’évaluation des jurys consultables en ligne pour chaque candidat, et tu croises tout cela avec les procédures de knowledge assessement qui gouvernent l’économie de la connaissance à partir des institutions européennes. Tu te fabriques une image du personnage de l’enseignant-chercheur que les pratiques d’évaluation – leurs attentes et leurs résultats – dessinent, et tu images une figure, ou mieux, un « profil » qui est celui d’un infatigable producteur de publications scientifiques évaluables – et tu te souviens des mails que tu as reçus, à l’époque du premier tour de la qualification, de la part de soi-disant maisons d’édition scientifiques : « Cher chercheur, nous vous invitons à nous confier votre manuscrit en format Word, nous pourrons bien l’imprimer dans quelques jours… », ou bien tu te souviens d’être tombé sur quelqu’un qui pratiquait l’art, assez répandu, de couper un livre en plusieurs morceaux pour en tirer d’autres livres qui ne seront jamais publiés mais qui, avec leur code ISBN, pourront être comptés en tant que publications distinctes. Un « doping de publications », lis-tu dans le livre de Valeria Pinto. Livres, articles, essais que sans doute personne ne lira jamais, les rapporteurs de la qualification, peut-être, non plus. Tu te demandes ce qu’il en est aujourd’hui de l’idée même de « public » et de sa relation avec le geste de l’écriture. Ceux qui écrivent, pourquoi le font-ils ? Au niveau de l’écriture et de ses styles, tu te demandes également quels effets cette course forcenée à la solidification de tout discours critique dans des produits scientifiques évaluables déterminera, tu te demandes s’il en reste quelque chose de l’élément esthétique de l’écriture, ainsi que de ses obstacles, ses paradoxes, des transformations et des abîmes qu’elle impose à la pensée. Tu imagines encore ce personnage de chercheur – ce profil –, et tu vois une silhouette aux contours bien définis, et tu ressens même à l’intérieur de toi-même le désir de correspondre à cette silhouette nette, claire, pleine, compacte, cohérente de toute part : chaque éventuel élément de « schizophrénie », ou seulement d’éclectisme, étant un signe évident d’immaturité scientifique. Ensuite, tu penses aux pratiques que l’autoproduction d’un profil employable dans le marché de l’évaluation favorise et sollicite. Tu te souviens d’une collègue française – fatiguée, épuisée – qui une fois t’a parlé de sa vie de « Robin des Bois » à l’inverse : « quand je dois organiser un colloque international – elle te disait –, j’établis des frais d’inscription pour les jeunes chercheurs pas connus, ceux qui comptent pour rien et qui doivent se faire connaître et gagner un peu de visibilité, et avec les sous que je reçois d’eux, je paie les keynote speakers, les professeurs importants, avec lesquels je dois tisser des relations ou faire de la ‘campagne électorale’ pour les concours », « ou bien – te disait-elle encore –, si je dois diriger l’édition d’un ouvrage collectif en anglais, afin d’ajouter une ligne importante à mon CV, mais je n’ai pas l’argent pour les traductions des textes, alors je vais faire une call for translations et je profite du travail gratuit de ceux qui ont besoin de nourrir leur CV avec une traduction ». Tu imagines de vivre dans un monde où l’évaluation est partout, et tu imagines que ce monde est peuplé d’« ascètes de la performance » – comme le dirait un professeur de gestion que tu connais, Éric Pezet – et de micro-exploiteurs du travail d’autrui, et tu vois bien, dans ton imagination, comme ces figures se confondent dans les mêmes individus, les traversant sans cesse, et comme elles constituent la déclinaison intellectuelle de la libre entreprise de soi à l’âge de l’évaluation en tant que technologie de gouvernement. Tu penses qu’on peut dire tout et n’importe quoi des figures anthropologiques que tu es en train d’imaginer, mais non pas qu’elles soient des figures de l’obligation et de la coercition, et même pas de la servitude volontaire : personne n’est obligé de faire ce qu’il fait, dans ce petit monde libre et en overdose de publications, saturé de discours et ponctué de prises de parole continuelles. Du coup, tu imagines d’autres gestes, puisque tu comprends que pour rendre le discours inoffensif, il y a la censure, mais il y a aussi bien sa prolifération infinie quoique disciplinée, comme un bourdonnement continuel, sourd et ordonné, et tu imagines créer des zones de silence et d’écoute comme si elles étaient des pratiques de grève, tu penses à ce « devenir-imperceptible » dont parlaient Gilles Deleuze et Felix Guattari et dont il te semble comprendre quelque chose que maintenant, tu imagines que ce « courage de la vérité » dont on a beaucoup parlé dans ton milieu pendant ces dernières années puisse avoir affaire moins à l’énième prise de parole qu’à une mise en suspens du discours, mais tu as déjà trop imaginé, et ta matinée est désormais finie.
Imagine que maintenant c’est l’après-midi, c’est-à-dire la partie de la journée où tu dois chercher un travail et un salaire. Tu t’es inscrit au pôle-emploi, ils ne t’ont pas aidé. Par contre, ils t’ont proposé de fréquenter un atelier sur la création d’entreprise. Imagine que tu y sois allé : tu as rencontré des conseillers sérieux et très motivés, prêts à t’accompagner dans ton parcours entrepreneurial. Sauf que tu n’as pas un projet, tu dois encore l’imaginer. Ils t’ont donné beaucoup d’informations, tu as découvert qu’en France il existe le statut d’auto-entrepreneur, ce qui n’est pas comme la Partita Iva italienne, il s’agit en fait d’un statut que tu peux activer tout de suite en ligne, si tu travailles, alors tu factures et tu cotises, si tu ne travailles pas, tu ne vas ni facturer ni cotiser. Et si ça ne marche pas, tu clôtures ton statut. Les agents du pôle-emploi en sont enthousiastes, ils conseillent à tout le monde de devenir auto-entrepreneur. Imagine que juste le lendemain l’une des écoles de langues auxquelles tu as postulé comme professeur d’italien va te répondre – ce sera la seule à le faire – en te demandant de prendre le statut d’auto-entrepreneur pour l’enseignement de l’italien. Todos caballeros, voire tous entrepreneurs – te dis-tu. Mais cela ne t’étonne pas, parce que tu connais bien ce livre-là, celui de Foucault, le cours au Collège de France de 1979, toujours celui-là. C’est ce livre qui t’a appris que l’effort utopique néolibéral correspond à la transformation de la société dans une société faite d’unités-entreprises, avec la « démultiplication » de la forme-entreprise en tant que forme de la subjectivité. C’était ce livre, avec toute la littérature qui s’est développée à partir de là, qui t’a expliqué que l’omniprésence de la formule « capital humain » – formidable invention de l’École de Chicago – dans le discours politique et économique signifie « chacun entrepreneur de soi-même », chacun engagé dans la valorisation de ce capital qui coïncide avec l’ensemble de ses propres capacités, compétences, attitudes physiques et psychologiques. Si la matière dont la vie est faite – imagines-tu – doit être gérée en tant que capital, quelle forme devra-t-elle prendre cette vie – la tienne – sinon la forme de l’entreprise ? L’entreprise, est-elle une autre réalité de transaction – abstraite, ineffable, et concrète pourtant ? Et finalement tu as envie de rire, tellement tu vois partout des réalités de transaction ainsi que des superficies d’attaque pour une gouvernementalité, et tu te demandes à quel niveau de paranoïa tu es parvenu. Et pourtant, tu penses, Foucault nous a appris, grâce à des livres comme Surveiller et punir et des cours au Collège de France comme Le pouvoir psychiatrique, que l’enjeu du pouvoir disciplinaire, du pouvoir qui s’exerce sur la vie, c’est de produire une âme autour du corps, de donner une forme d’âme – une âme visible et « authentique » – à un corps ; un corps qui, en soi, n’est pas du tout substance biologique brute, cire attendant l’impression d’un sceau, mais « corps utopique », visible et invisible, ouvert et fermé, mystérieux et transparent, foyer permanent de formes possibles, faim et soif de subjectivations – voilà, tu t’imagines encore de donner un petit cours. Du coup, tu te poses la question : comment transformer une vie en capital humain ? Et tu imagines la réponse : en façonnant cette réalité de transaction qu’on appelle âme – la nietzschéenne prison du corps – selon la forme de l’entreprise. Et comment cela se fait ? – te demandes-tu encore. Et quel lien avec l’évaluation comme technologie de gouvernement ? Imagine que tu trouves la réponse en ce que tu es en train de faire cet après-midi pour chercher du boulot : CV et lettre de motivation, CV et lettre de motivation, CV et lettre de motivation. Imagine toi écrire et réécrire plusieurs versions de ton CV et autant – même plus – de lettres de motivation : ça dépend du destinataire de ta candidature, de qui va évaluer ton dossier, du genre d’emploi que tu postules. Ancienne invention, le curriculum vitae. Il te semble avoir lu que ça remonte à la fin du 19e siècle que c’est une pratique née dans le milieu militaire, et c’est presque toujours comme ça quand il s’agit de pratiques de recrutement et d’embauche. Tu imagines quand même que ton père et ta mère n’ont jamais écrit un CV de toute leur vie, peut-être juste une fois pendant leur entière vie de travailleurs, et tu imagines bien. Toi, par contre, qui espères être à moins de la moitié de ta vie, tu en as déjà écrits, envoyés et faits examiner des centaines, peut-être, si tu les comptes, ils vont dépasser le millier, et pour un moment tu t’imagines comme une étrange créature hybride, entre la machine et l’homme, qui sans cesse se redouble, s’observe, se contemple, se surveille, se gouverne – et jusqu’ici, rien d’étrange, tu penses, c’est le mouvement de la conscience, le jeu des instances psychiques, la condamnation à la transcendance de l’« animal qui parle » –, mais qui inscrit tout cela dans la structure d’un CV, comme les imprimantes d’autrefois, celles qui vomissaient des feuilles perforées et interminables, ainsi tu ne cesses pas de déplier en face de toi-même ta vie, tes gestes, tes choix, sous la forme d’un CV. Tu te demandes si ton imagination n’en rajoute pas, et tu te réponds en te demandent combien de fois, dans ta vie, as-tu réglé tes expériences et tes choix selon leur pertinence à un CV et leur capacité d’y ajouter une ligne, combien de fois as-tu consigné, à ce CV-là, à son idéal, à son phantasme, le pouvoir de décider de ton existence. Beaucoup de fois, te dis-tu, et pourtant trop peu, vu que tu en paies les conséquences, étant donné que, pour l’énième fois, tu postules un emploi. Imagine mentir au moins un peu, quand tu rédiges ton CV et quand, dans la lettre de motivation, tu l’expliques, tu le justifies, tu en remplis les trous. Imagine ne pas arriver à coïncider avec l’image vitrifiée que tu donnes de toi-même, imagine la décaler, mais aussi la poursuivre, cette image, et son sens de cohérence, de plénitude, de lucidité, « comme si tu étais en retard sur la vie » – il te suggère avec malice un petit bouquin de René Char, caché dans tes livres de philo. Imagine poursuivre cette image comme on poursuit l’illusion du miroir, avec sa capacité de solidification imaginaire, de refermer et « cacher un instant l’utopie profonde et souveraine de notre corps », comme l’a dit une fois Foucault dans une conférence radiophonique en 1966. Le CV, miroir de l’âme. Quoique tu mentes, quoique tu sois voué à une philosophique mauvaise foi, quoique tu fasses profession de distance ironique par rapport à tes efforts de te rendre objet désirable sur le marché du travail, tu sais bien combien il est important de modéliser sa propre histoire dans un profil spécifique, cohérent, linéaire, progressif, discipliné – et cela te ramène, par ailleurs, aux pratiques d’évaluation de ce matin –, et du coup tu le fais, et tu crains de ne pas le faire assez. Tu penses qu’il faudra étudier, tôt ou tard, ce « jeu de vérité » sur soi-même qu’on appelle curriculum vitae, ainsi que les effets collatéraux de subjectivation qui se produisent à l’intérieur du geste, sans cesse relancé, d’écriture et réécriture de l’image de soi. Pour l’instant, tu imagines vivre dans un monde où l’(auto)évaluation est partout. Et d’ailleurs, tu te rends aussi compte que les mêmes pratiques d’autoévaluation et d’autogouvernement mises en place pour décrocher un boulot dans un marché hyperconcurrentiel sont codifiées, instituées et validées à l’intérieur même des entreprises auprès desquelles tu postules. Imagine, en effet, d’avoir lu quelques manuels de gestion de ressources humaines, pour essayer d’entrer dans le monde où les gens qui t’évaluent vivent ou bien imaginent avoir travaillé dans ce domaine, ou dans celui de la formation continue, financée par les institutions européennes, celle qui a pour but la valorisation et le développement du capital humain. Tu as, d’ailleurs, une formation en sciences humaines, et si tu veux travailler en entreprise, tu ne peux qu’entrer par la porte des ressources humaines, selon tous les lieux communs sur l’« employabilité » des « humanistes ». Ces manuels, ces expériences te répètent que le monde a changé, le travail s’est transformé, et le beau monde de Brecht, comme le disait déjà Pasolini, n’existe plus. Quelle nouveauté ! – tu te dis : c’est depuis le lycée que tu entends la chanson de la mondialisation et de la flexibilité, celle qui annonce que le conflit n’est plus entre capital et travail mais entre ceux qui ont le courage de prendre le train du changement et les réactionnaires qui cherchent à l’arrêter. Dans ce nouveau monde – tu l’as découvert –, les contrats juridiques qui règlent les relations de travail ne sont que des oripeaux inutiles qui en revanche rendent les organisations rigides et lourdes, alors qu’elles doivent être, aujourd’hui, souples et ductiles, à même de vibrer comme une anche au souffle irrégulier des marchés. Il faut qu’un autre genre de normativité intervienne pour régler la relation de travail – pardon : le rapport de collaboration –, une normativité d’ordre psychologique. On parle de « contrat psychologique », en fait, ce qui signifie un échange de promesses qui ne s’écrit pas dans le contrat juridique, du moins pas entièrement – c’est ce que tu as appris. Auparavant, le contrat psychologique se faisait en termes d’assujettissement contre salaire, de dévouement en échange d’un emploi stable ; aujourd’hui, il est fait de motivation, implication, identification avec l’entreprise, dans une relation de travail qui devient volatile comme un gaz. Capital et Travail : tu imagines le Deux qui devient Un, et non pas parce que la fatigue solide du travail subordonné et commandé se disperserait enfin dans une société de producteurs libres et indépendants, mais parce que – imagines-tu – chacun devient une particule imparfaite qui participe à une idée quasi-platonique d’entreprise, une fibre docile de cet univers qu’on appelle entreprise. « Identification organisationnelle » : imagine d’avoir bien compris que cette notion est une notion fondamentale dans les pratiques managériales contemporaines. C’est l’identification avec l’entreprise qui pousse les gens vers une posture proactive et auto-entrepreneuriale, qui promeut le commitment et favorise le contrat psychologique, dans des entreprises où les salariés sont des collaborateurs, le mot « contrôle » est toujours accompagné par le préfixe « auto », et les gens doivent faire appel moins à la hiérarchie qu’à leur propre personnalité pour atteindre les objectifs de l’entreprise – comme tu l’as lu dans un livre de management consacré à l’identification organisationnelle. Tu te demandes si tout cela te concerne ou s’il s’agit de quelque chose qui ne regarde que le monde des managers et cadres, si ces discours tournent dans le vide ou s’ils font partie de ce que les philosophes appelaient Zeitgeist, l’esprit du temps. Tu te souviens de quand tu travaillais dans le domaine de la formation continue et que tu organisais des cours obligatoires de communication et team working, de gestion du stress, de création d’entreprise, de techniques de leadership, etc. pour des apprentis ouvriers tourneurs, fraiseurs, opérateurs sur machines à commande numérique, ou bien plombiers, électriciens, vendeurs, etc. ; tu te souviens de quand, il y a quelque temps, tu as fait un entretien de groupe pour un poste de vendeur dans un supermarché et tu as participé à un role playing où il s’agissait de décider tous ensemble, en mettant en scène un brain storming, quelles sont les dix qualités qui définissent un vrai leader d’aujourd’hui ; tu te souviens que, pris au dépourvu, tu n’as rien dit et en fait tu n’as pas obtenu le poste ; tu te souviens que le langage managérial que tu retrouves dans les livres, tu le repères aussi bien dans les documents du Fond Social Européen et dans la plupart du discours politique qui concerne le travail, l’école, l’université ; du coup tu penses que la frontière entre les pratiques managériales et ce qui devrait en être étranger, hétérogène ou du moins différent, cette frontière peut-être n’existe même pas, et tu imagines que les discours managériaux ne sont que la codification contemporaine d’une technique de gouvernement qui, du sol, les excède, les soutient, les fait fonctionner. Et comme tu imagines de vivre dans un monde où l’évaluation est partout, tu te souviens aussi d’avoir lu dans la littérature managériale que les pratiques d’évaluation du travail, des performances, du potentiel de la ressource humaine ont affaire à la construction de l’« image de soi » – oui, de l’image de soi –, à la représentation de sa propre personnalité, de son propre rôle social. Un psychologue du travail qui s’appelle Claude Lévy-Leboyer t’a appris que la construction de l’image de soi est le véritable enjeu des pratiques d’évaluation du travail, ce qui permet à la ressource humaine de se connaître elle-même, de satisfaire l’« appétit de savoir » qui la concerne, d’augmenter la lucidité, la qualité et la pertinence de sa propre image pour pouvoir enfin se manifester à soi-même et se transformer, développer, augmenter sa puissance. En même temps, l’évaluation des ressources humaines fournit à l’entreprise une description exacte de l’individu, en traquant sa vérité, en vérifiant sa compatibilité avec l’organisation, en saisissant son potentiel, en traçant les lignes de son développement possible. Tu apprends que la construction de l’image de soi est l’un des éléments de ce contrat psychologique qui scelle le lien immatériel entre l’individu et l’entreprise, c’est l’un des éléments de la rétribution aussi, parfois le plus important, parfois le seul : travaille pour moi et je te dirai qui tu es. Et qui tu peux devenir. Tu te demandes quelle forme va-t-elle prendre cette énième déclinaison du « supplément d’âme » que l’image de soi – comme un miroir – peut insuffler dans les individus, et tu te rends compte que tout pivote autour de la notion de « compétence ». Tu imagines ton image – celle que tu poursuis du matin au soir pendant que tu cours après un boulot –, et elle se manifeste comme une cartographie de tes compétences, transparente et bien accessible à la conscience, capable de renforcer ce qu’une certaine psychologie appelle « auto-efficacité ». Tu t’imagines toi-même comme une constellation de compétences qu’il faut connaître, mettre à jour, valoriser, et sur lesquelles il faut que tu investisses. Les compétences : la seule chose que tu peux diagnostiquer et changer, quand ta personnalité résiste tenacement aux changements, et l’inconscient – postulant que tu en aies un –, échappe par définition à la maîtrise du sujet souverain que tu voudrais être. Les compétences : la seule chose que tu peux gérer comme si tu étais le manager de toi-même. Tu commences à comprendre comment, à travers l’authentification de soi en tant qu’agrégation de compétences évaluables et traduisibles en CV, une vie – la tienne – se transforme en capital humain. Le CV, miroir d’une âme qui se fait entreprise.
C’est presque le soir, ton après-midi de recherche de travail est désormais terminé. Imagine éteindre l’ordinateur, les yeux qui brillent de fatigue, même si tu n’as rien fait sauf imaginer. Tu as compris que l’évaluation est cette technique de gouvernement qui relie tes matinées et tes après-midis, puisqu’elle organise les environnements dans lesquels tu vis, puisqu’elle est le nécessaire outil de mesure de la valeur de ton capital humain et des investissements que tu en as faits, puisqu’elle a affaire à ces questions scabreuses qui concernent l’identité, la subjectivation, la reconnaissance, le narcissisme – appelle-les comme tu veux –, à la production d’une véritable image de soi. Tu as compris que cette image est valeur d’usage et valeur d’échange dans le marché, enjeu d’une micro-politique qui investit tes gestes quotidiens, point d’arrivée inatteignable d’une théorie d’exercices qui ressemble à une ascèse wébérienne intramondaine, qui ressemble, finalement, à quelque chose comme une discipline – sortie par la porte, rentrée par la fenêtre. Tu as envie de poursuivre et approfondir tes études, de relier les pratiques d’évaluation aux analyses de Foucault sur le pouvoir pastoral et sur l’aveu comme dispositif de subjectivation, de te mettre toi aussi à chercher la généalogie du management dans les techniques chrétiennes de gouvernement des âmes – d’autant plus que tu as vu sur internet, juste avant d’éteindre l’ordinateur, que la Pontificia Universitas Lateranensis, « en suivant l’enseignement du Pape François », organise le premier cours de « management pastoral » pour « optimiser les ressources humaines et économiques, en alliant compétence et Évangile » : le management, fils prodigue, est revenu à la maison. Mais finalement tu ne le feras pas, tu te diras que tu n’as plus de temps, au contraire, qu’il est temps de disperser ce savoir dans les pratiques de vie – les tiennes –, pour les changer, pour les rendre loquaces, avant qu’elles divorcent pour toujours des beaux discours ; tu te diras qu’au pessimisme de la raison – comme le disait Franco Basaglia en paraphrasant Gramsci – il faut coupler l’optimisme des pratiques, parce que tu n’es pas en dehors du monde de l’évaluation, et tu n’en sortiras pas grâce à un bond du discours, et parce que tu n’es pas une victime : toi aussi, comme tout le monde, tu es un homme qui évalue.
Pubblicato il 9 febbraio 2015,
è apparso sul numero 4 di “Im@ago” (imagojournal. it), nella sezione “L’immaginario della valutazione”,
a cura di Valeria Pinto e Massimiliano Nicoli.
Première publication en français dans la Revue Economique et Sociale (vol. 74, n° 2, juin 2016, p. 87-97).










 Suite à
Suite à  Partout dans le monde, l'application du néo-libéralisme à l'Enseignement Supérieur et à la Recherche entraîne une multiplication des fraudes. On en trouvera un exemple en Côte d'Ivoire, via le combat du collectif des enseignants-chercheurs et chercheurs de l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan Cocody (Codec). Ce collectif est monté au créneau pour tenter de désamorcer le conflit qui les oppose au président de l'Université. Dans une déclaration faite à la presse, Dr Oumar Yéo et ses camarades démontent la gestion du Pr. Abou Karamoko et lui font des
Partout dans le monde, l'application du néo-libéralisme à l'Enseignement Supérieur et à la Recherche entraîne une multiplication des fraudes. On en trouvera un exemple en Côte d'Ivoire, via le combat du collectif des enseignants-chercheurs et chercheurs de l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan Cocody (Codec). Ce collectif est monté au créneau pour tenter de désamorcer le conflit qui les oppose au président de l'Université. Dans une déclaration faite à la presse, Dr Oumar Yéo et ses camarades démontent la gestion du Pr. Abou Karamoko et lui font des  Des
Des  Comme nous le signalions déjà dans la
Comme nous le signalions déjà dans la 
 Des affrontements entre des étudiants affiliés à l’Union Générale des étudiants de Tunisie (UGET) et la police ont eu lieu le mercredi 10 avril 2019, devant
Des affrontements entre des étudiants affiliés à l’Union Générale des étudiants de Tunisie (UGET) et la police ont eu lieu le mercredi 10 avril 2019, devant  Zambian education authorities Friday April 5
Zambian education authorities Friday April 5  Thousands of students across Ontario
Thousands of students across Ontario  After
After  After two weeks on the picket line and more than a year at the bargaining table, teaching and graduate assistants at the University of Illinois at Chicago have
After two weeks on the picket line and more than a year at the bargaining table, teaching and graduate assistants at the University of Illinois at Chicago have 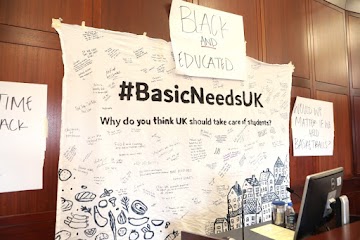 More than
More than  Strike,
Strike,  El centro de Bogota es,
El centro de Bogota es,  Movimientos independientes de estudiantes
Movimientos independientes de estudiantes  Ils étaient des milliers à battre le pavé dans toute la France.
Ils étaient des milliers à battre le pavé dans toute la France. 
 Dans le cadre de la rébellion internationale d'enseignants, le lundi 8 avril, plus de 80% des 400.000 enseignants polonais ont rejoint une
Dans le cadre de la rébellion internationale d'enseignants, le lundi 8 avril, plus de 80% des 400.000 enseignants polonais ont rejoint une  Tasmanian teachers
Tasmanian teachers