Qui gouverne la science ? Langage et acteurs des politiques de la recherche et de l’enseignement supérieur en France
fr-FR
Nous republions ci-dessous l’entretien qu’a accordé, en février 2020, Christian Topalov à Wolf Feuerhahn et Olivier Orain pour la Revue d’histoire des sciences humaines. On y lira une remarquable synthèse de la fabrication, dans les dernières décennies, de la recherche et de l’université néolibérales en France. Tout ou presque des ingrédients qui ont concouru au remodelage sont passés en revue par Christian Topalov, à travers une analyse à la fois fouillée, fine et percutante. Du cynisme des cercles dirigeants à la servitude volontaire des « petits soldats » de l’expertise, de la nouvelle architecture institutionnelle organisatrice de la concurrence à la violence ou aux faux-semblants du langage, ce sont trente ans de grignotage – le mot est essentiel – qui se trouvent reconstitués, appelant à la nécessaire et complète révolte et refonte. L’entretien paraîtra à certains un peu long, mais il vaut assurément le détour.
La Rédaction du blog
Wolf Feuerhahn : Cher Christian, merci beaucoup d’avoir accepté notre invitation ! Afin de ne pas imposer un cadrage temporel qui serait le nôtre, nous souhaitons commencer par vous demander comment vous scanderiez et borneriez l’histoire des politiques publiques de l’enseignement supérieur et de la recherche, en France, en tant qu’elles ont une incidence sur la situation actuelle ?
Christian Topalov : Le récit que vous me demandez de faire est nécessairement une prise de position. Il y a, en effet, diverses façons de raconter la séquence réformatrice qu’a connue l’enseignement supérieur et la recherche (ESR) en France depuis une quinzaine d’années. C’est ce que veulent nous empêcher de penser les « experts » qui nous offrent une histoire unique : celle de la crise de l’université française et de la sortie de cette situation fâcheuse par des réformes qui nous permettent de revenir peu à peu dans la compétition internationale, malgré le retard pris. Ce discours est constamment diffusé par les institutions et leurs experts, qu’ils soient missionnés, consultés ou dotés de pouvoirs d’inspection, mais aussi par une « sociologie d’expertise » financée par les institutions mêmes qu’elle étudie. Pour ma part, je ne revendique pas l’objectivité, je vous proposerai un récit engagé – qui est en même temps, à mon avis, réaliste.

Parmi les modes de description possibles, deux s’opposent polairement. Selon le premier, issu d’un mixte surprenant de sociologie des organisations classique et de langage interactionniste (1), les réformes s’analysent comme une série de mesures parcellaires, fragmentaires, hésitantes. Elles résultent d’un jeu ouvert, où chaque acteur donne consistance de façon imprévisible à des cadres institutionnels où ne prévaut aucune inégalité décisive des rapports de pouvoir. Selon l’autre interprétation, généralement critique, les réformes déroulent, dans un cadre politique national chaque fois spécifique, un projet global cohérent défini par des institutions internationales – notamment l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et les diverses instances de l’Union européenne qui promeuvent le « processus de Bologne (2) ». Dans cette perspective, les réformes s’imposent implacablement et vont toutes dans la même direction. Ce récit est tentant, parce que les mesures partielles prises en France au fil du temps, dans le désordre apparent et l’urgence, ont produit des effets d’une grande cohérence. Mais je ne crois pas pour autant qu’elles résultent simplement d’une doctrine : les « idéologies » ne déterminent pas le cours de l’histoire. Disons plutôt que certains acteurs dominants ou devenus tels dans le monde de l’ESR ont puisé dans une doctrine relativement plastique un langage et des ressources qui leur ont permis de promouvoir ce qu’ils construisaient peu à peu comme leurs intérêts. C’est seulement a posteriori que l’on peut regarder les résultats de ce processus comme cohérents. C’est une cohérence ainsi construite que je peux vous proposer, ce qui est d’ailleurs le cas de tout récit historique un tant soit peu réflexif.

Avant d’évoquer quelques exemples de cette cohérence ex post, je voudrais relever que les gouvernants qui ont imposé les réformes ont montré une grande intelligence tactique, car ils ont généralement eu soin de fractionner les mesures pour les rendre acceptables. Ils pouvaient donc dire à la fois : « c’est très urgent, il faut absolument le faire ; mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas changer grand-chose à vos habitudes ». Les recommandations du rapport Aghion-Cohen de 2004 ont été entendues : « l’échec de la “méthode Allègre” est là pour nous rappeler qu’une réforme globale est d’autant plus impossible qu’elle est audacieuse ou au moins présentée comme telle. Pour éviter de se heurter à un front de résistance interne et externe qui conduiraient à l’échec, la réforme doit être menée pas à pas, sans proclamation tonitruante ». Leur scénario « propose donc de poursuivre et de multiplier les réformes incrémentales, les petits dispositifs qui permettront, sans trop provoquer de remous, d’introduire de vraies évolutions dans le système actuel (3) ». Le double argument de l’urgence et de la modestie des réformes a été mobilisé à chaque étape, diversement toutefois selon les théâtres d’énonciation : dans certains rapports passablement confidentiels, on définissait des réformes radicales ; sur la scène politique, on affichait de grands objectifs consensuels et dans les établissements, à la base, on calmait le jeu. Autre aspect tactique fondamental : à chaque étape, aussi, la collaboration des universitaires et des chercheurs ou, du moins, celle de quelques-uns, était sollicitée par les autorités. Les états-majors de la réforme ont su ainsi recruter à la fois des petits soldats convaincus qui pensaient aussi pouvoir tirer profit des changements, et des collaborateurs rétifs qui pensaient pouvoir en limiter les effets néfastes. Cette tactique du pas à pas et du « rien sans vous » a fini par créer des situations que beaucoup jugent désormais irréversibles : « il faut s’adapter », n’est-ce pas, au nouveau monde.

On ne pouvait pas imaginer, par exemple, que la Loi relative aux libertés et responsabilités des universités (dite LRU), qui a attribué la fameuse « autonomie » aux présidents des universités et à leur cercle rapproché, aurait finalement deux résultats essentiels. Le premier a été d’obtenir de la plupart des établissements une austérité auto-administrée et des solutions fondées sur la précarisation des personnels : tandis que la fongibilité asymétrique (4) interdisait de créer des postes de fonctionnaires au-delà de ce qui est permis par le ministère, la compression des budgets empêchait souvent de pourvoir tous les postes pour pouvoir réparer la toiture, tandis qu’elle poussait à rechercher des ressources propres du côté des entreprises ou de l’augmentation des frais d’inscription – pour l’instant avec les diplômes d’université et les étudiants extra-européens, mais on peut craindre que la barrière légale cède bientôt. Le second résultat a été d’imposer à toutes les universités devenues autonomes d’entrer dans une compétition généralisée : pour être bien vues par l’agence de notation, puis par le jury Idex (« initiatives d’excellence »), pour bénéficier des contrats de l’agence de financement par projets, pour attirer les « meilleurs étudiants » par la procédure Parcoursup et les plus solvables des étudiants internationaux, désormais rentables. On ne savait pas tout cela en 2007, mais on peut relire rétrospectivement la loi LRU comme une étape essentielle vers des universités concurrentielles, c’est-à-dire vers la guerre de tous contre tous.

Prenons un autre exemple : le rôle de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES). L’objectif affiché en 2005 était de généraliser l’évaluation à toutes les entités de l’ESR et de répandre une nouvelle « culture de l’évaluation ». C’était déjà beaucoup. Mais on ne pouvait pas imaginer alors que les notes attribuées alors par l’AERES allaient définir les « périmètres d’excellence » qui s’imposeraient lorsque s’ouvriraient, en 2010, les procédures de sélection des institutions d’excellence qui allaient définitivement casser en deux l’universitas. Lorsqu’en 2010 furent rédigés, dans la précipitation générale, les projets pour les « initiatives d’excellence », il apparut que seules des unités de recherche notées A+ ou A par l’AERES pouvaient entrer dans un Labex (« laboratoire d’excellence »). Il apparut aussi qu’au sein des établissements composant les super-universités du futur (les Idex), seul un « périmètre d’excellence » bénéficierait de la manne du « grand emprunt ». Et pour être inclus dans le dit périmètre, bien sûr, il fallait avoir été noté A+ ou A. On s’aperçut alors que l’AERES avait été l’instrument d’une concurrence au couteau non seulement entre établissements, mais aussi à l’intérieur de chacun d’eux. D’ailleurs, une fois lancée la course à l’excellence, l’AERES annonça en décembre 2011 qu’elle renonçait à la notation synthétique des unités de recherche. Sa mauvaise action étant faite, elle pouvait sans dommage faire cette concession au mécontentement général contre ses méthodes. Il n’est pas impossible que, sous la présidence annoncée de Thierry Coulhon (un personnage sur lequel je reviendrai), l’agence pratique bientôt une évaluation moins « euphémisée », au service de la politique « inégalitaire » et « darwinienne » qu’appelle de ses vœux Antoine Petit, le P.-D.G. du CNRS (5).
Dernier exemple : les pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES), introduits sur un mode facultatif par Pécresse, et les communauté d’universités et établissements (COMUE) sur un mode obligatoire par Fioraso. Ces regroupements d’établissements étaient à l’origine présentés de façon anodine comme des moyens de rationaliser l’offre d’enseignement dans un territoire ou de mutualiser des services. Ils ont en réalité servi de support à des opérations de fusion d’universités qui s’accompagnaient d’une marginalisation des élus des personnels et des étudiants et, dans certains cas, d’un renforcement massif des pouvoirs du président. Ainsi, les PRES de 2009 ont rapidement ouvert la voie à la vaste mise en scène du concours Idex ouvert en 2010 et ainsi, à la création d’une dizaine d’établissements supposément « d’excellence » et visibles depuis Shanghai, dotés de moyens importants qui étaient refusés aux autres universités. La transformation des PRES en COMUE et la doctrine opiniâtrement imposée par le « jury international » taillé sur mesure par l’Agence nationale de la recherche (ANR) ont abouti à des institutions de « gouvernance resserrée » fermant définitivement toute influence de la communauté universitaire sur ses institutions. Projet cohérent dès l’origine ? Sans doute, si on lit le rapport Aghion-Cohen de 2004 et, plus nettement encore, le rapport Aghion de 2010 (6). Cohérence lisible a posteriori, plutôt, si l’on observe les hésitations et les impasses dans certaines modalités de mise en œuvre : les COMUE de Fioraso sont tombées en désuétude sous Vidal (7), sans qu’il soit même besoin de prendre un nouveau texte, les regroupements d’universités n’ont pas toujours suivi les consignes du ministère et le résultat final fut parfois tortueux, en particulier en région parisienne. Mais ce sont là des détails.
Je vais maintenant essayer de répondre à votre question sur le bornage et la scansion des réformes. Je crois qu’il faut remonter à 2005-2006 pour observer les premières mesures d’un cataclysme qui s’est développé depuis avec constance, quel que soit le gouvernement ou le ministre, bien qu’à un rythme variable. Bien sûr, on peut remonter plus haut : Devaquet en 1986, Allègre en 1999, Ferry en 2003. Mais ces gens ont soit échoué devant la protestation, soit été plus bavards qu’efficaces. En outre, ils ne disposaient pas encore d’une ligne stratégique d’ensemble appuyée sur « l’Europe », sur la Conférence des présidents d’université (CPU), sur des cohortes d’anciens scientifiques et de hauts fonctionnaires devenus militants de la réforme, sur la construction méthodique d’un sens commun.
Ces gens-là sont persuadés, ou ont décidé de l’être, que l’université est en crise et que la recherche française décroche dans la compétition internationale. Ils imaginent que c’est avec le classement de Shanghai en tête que les étudiants étrangers décident ou non de venir en France. Ils croient qu’il faut piloter, « manager », inculquer leurs croyances à ceux qui sont l’université et font la vie des laboratoires. Ils ont pour eux, pour nous, un mépris sans borne. C’est pourquoi, ce qu’ils veulent d’abord et surtout, c’est changer le mode de gouvernement des institutions savantes. Si l’on regarde les choses d’un peu près, on s’aperçoit que ce dont il s’agit avec les réformes, c’est d’en finir avec les effets des trois moments cruciaux de démocratisation de l’université française qu’ont été 1945, 1968 et 1981. La Libération, c’est simultanément la création du Conseil national des universités (CNU) et celle du Comité national de la recherche scientifique (CoNRS) – les ordonnances ont été prises le même jour. Ces deux institutions avaient une même finalité : protéger de l’autorité administrative, l’une les professeurs (qui étaient fonctionnaires), l’autre les chercheurs du CNRS (qui étaient alors des agents contractuels de l’État). Recrutement, carrière et évaluation des universitaires et des scientifiques ne devaient pas dépendre d’une autorité administrative ou politique, mais du jugement de leurs pairs – majoritairement élus (8). Voilà la raison d’être de ces deux institutions, que les réformes ont déjà marginalisée (le CoNRS) et visent maintenant à faire disparaître (le CNU) (9). Mai 1968, c’est ce qui a conduit à la loi Faure (10) qui rendit les universités autonomes du ministère tout en secouant l’ancien régime des facultés : les universités étaient désormais dirigées par un conseil majoritairement élu qui élisait son président. C’est un moment tout à fait crucial, même si l’argent venait toujours du ministère – comme aujourd’hui, par parenthèse, et avec des conditions plus drastiques que jadis, car le nouveau management public est passé par là. Le troisième moment, avec le gouvernement d’union de la gauche de Mitterrand, c’est la loi Savary de 1984 qui démocratisa les universités que la loi Faure avait mises en place : désormais le président n’était plus élu par 30 personnes – d’ailleurs, la loi Faure ne donnait pas le nombre du conseil en question et ne lui donnait même pas de nom – mais par 120 ou 140. Les trois conseils de la loi Savary – conseil d’administration, conseil scientifique, conseil de la vie étudiante – allaient se réunir en une sorte de congrès pour faire les présidents. Des présidents que les réformateurs vont décrire comme impuissants mais qui, surtout, étaient des nôtres : ce primus inter pares était un collègue parmi d’autres qui avait pris un job pour les cinq ans réglementaires (non renouvelables), devait négocier avec tout le monde pour faire des choses ensemble et qui, souvent ou parfois (cela reste à établir), revenait dans les amphis et à ses chers travaux une fois son mandat accompli. C’est ce dispositif-là qu’il fallait détruire. Les réformateurs s’y sont employés et je crains qu’ils aient à peu près réussi.
Olivier Orain : Une question là-dessus Christian : quand vous dites « le dispositif à détruire », est-ce qu’on a des indices, des textes de rapporteurs très proches des cercles gouvernementaux ou autres, qui l’ont explicité ?
Christian Topalov : Non, pas que je sache. On ne peut pas critiquer la Libération qui est (pour combien de temps ?) presque intouchable, on n’a pas besoin de critiquer Mitterrand, qui a enterré la gauche de jadis. Les politiques du genre Ferry, Sarkozy ou Pécresse proclamaient, en revanche, qu’il fallait « en finir avec 68 » (11). Mais c’était là un effet de manche, cela ne visait pas spécifiquement le changement des rapports de pouvoir à l’université. Car la réforme, voyez-vous, ce n’est pas de la politique : elle répond rationnellement à des problèmes réels. Tous peuvent s’accorder sur le diagnostic, et donc sur les solutions. Missions d’expertise, commissions parlementaires, inspections hors de tout soupçon de parti pris, évaluations indépendantes, consultations larges de la « communauté » : toutes ces formes ont été utilisées pour construire l’université et la recherche comme des problèmes dont les solutions s’imposaient. Le fait que la droite et Goulard-Pécresse avaient enfin pu réaliser ce que le socialiste Allègre avait rêvé avant et que la socialiste Fioraso ne fit qu’entériner après montre bien que la réforme de l’ESR est à l’abri des alternances politiques. Il y a néanmoins des cibles plus spécifiques : si la loi Faure est critiquée, c’est parce qu’elle a « émietté » l’université, si la loi Savary l’est aussi, c’est parce qu’elle a organisé l’impuissance de sa « gouvernance ».
Wolf Feuerhahn : Juste un petit détail. Dans ce contexte-là, de ces trois moments que vous identifiez, est-ce que vous incluez aussi tout ce qui a concerné la recherche, notamment les réformes de Jean-Pierre Chevènement, un peu avant Alain Savary ? Quel statut donnez-vous à cela ?
Olivier Orain : Notamment la réforme de 1982…

Christian Topalov : Bien entendu, la titularisation des chercheurs du CNRS a été une catastrophe aux yeux des réformateurs. Mais, désormais, priver du statut de fonctionnaire les directeurs de recherche ou les professeurs est un peu trop gros pour être envisagé. En revanche, ils peuvent s’attaquer aux débuts de carrière : réduire le nombre de postes mis au concours, multiplier les « post-docs » et autres statuts précaires. On est tellement plus créatif quand on ne sait pas comment on va vivre dans trois mois. Peut-être, même, avec la radicalisation des réformes promise par la Macronie, vont-ils cesser de recruter des chargés de recherche (CR) et des maîtres de conférences (MCF) : contrats de projet (CDD sans terme fixe), chaires de professeur junior (CDD de cinq ou six ans), versement massif de professeurs agrégés de l’enseignement secondaire dans les licences et les universités de second rang. Les plus enragés des réformateurs demandent la mise en extinction des corps de MCF et CR. Ce qui permet aux autres de paraître « raisonnables » en n’allant pas jusque-là… Tous, en tout cas, sont d’accord pour confier aux présidents d’université, les nouveaux managers, le pouvoir sur la définition des services, les recrutements, les promotions. Bref, de faire des universitaires des employés comme les autres.
Qu’est-ce que les réformateurs ont fait, au total, depuis une quinzaine d’années, et qu’ils pensent pouvoir, avec Macron, pousser encore plus loin ? Quels sont les points cruciaux ? Je vais essayer de répondre à cette question dans un ordre qui n’est pas chronologique mais, disons, stratégique – en soulignant quatre aspects fondamentaux des réformes. Le premier, ça a été de faire croire aux présidents d’université qu’on allait leur remettre le pouvoir et leur permettre de devenir de vrais patrons d’entreprise. On sait que la CPU a été, depuis l’époque d’Allègre, une des forces principales d’appui à la réforme : car celle-ci n’est pas née toute armée dans les états-majors politico-bureaucratiques nationaux et européens, elle a aussi été élaborée par des groupes bien précis d’universitaires et de chercheurs. Les présidents d’université ont été évidemment un fer de lance en ce qui concerne la dite « autonomie » des universités et la réforme de leur « gouvernance ». De ce point de vue, la loi LRU de 2007 a été un moment crucial : au lieu d’avoir un président élu par 120 personnes, il l’était désormais par une douzaine, parmi lesquelles la liste du futur président était assurée de la majorité absolue. Les nominations de personnalités au conseil par le président contribuaient aussi à assurer le silence dans les rangs. Quant aux pouvoirs accordés au président, ils sont de plus en plus larges, même si la résistance des universitaires et, parfois, la conviction du président ou de la présidente qu’elle est restée l’une des nôtres font que, dans la pratique, ils sont limités.
Olivier Orain : Pour les recrutements, les présidents, dans les faits, délèguent souvent aux collègues de la discipline le soin de constituer les comités de sélection : ils leur donnent une sorte d’imprimatur par contrôle a posteriori.
Christian Topalov : Entre la réforme de papier et la réforme de terrain, il y a toute l’épaisseur des rapports sociaux – ce que les réformateurs appellent « les conservatismes ». Un bel exemple en est le refus des sections du CNU, depuis maintenant une bonne douzaine d’années, de pratiquer l’évaluation récurrente des enseignants-chercheurs prescrite par la loi. Elles font ainsi obstacle à la modulation de service par les présidents – qui signifierait, en clair, la possibilité d’obliger une partie des enseignants à renoncer à la recherche pour faire plus de cours. C’est la raison pour laquelle le lobby des présidents espère obtenir de la Macronie la suppression du CNU, qui serait remplacé par des évaluations locales des enseignants. Donc, il y a des résistances, parfois efficaces. Mais les pouvoirs accordés par la loi ne sont pas sans conséquence : à Strasbourg, par exemple, une des universités modèles des réformateurs, il y a eu un assez gros scandale en 2012 quand le conseil d’administration a décidé de ne pas recruter un candidat choisi par un comité de sélection. On a donc toute une gamme de pratiques, tantôt plus proches de l’autonomie savante, tantôt allant jusqu’à l’arbitraire politique ou de clique.
Olivier Orain : Je ferais volontiers une incidente : il y avait un système hérité, auto-organisé, de sélection par les pairs qui fonctionnait et qui s’est perpétué parce qu’il était plus « coûteux » de le remplacer entièrement. Comme dans cette succession de réformes il s’agit aussi implicitement de donner de moins en moins d’argent et de faire des économies sur le dos de l’enseignement supérieur et de la recherche, je suppose que nombre de présidents n’ont, en réalité, pas les moyens d’avoir une politique « totale » qui déciderait de tout. Dès lors, ils sont assez souvent bien contents d’avoir cette auto-organisation qui continue à fonctionner parce qu’ils n’ont pas l’information et les moyens intellectuels de se substituer à des collectifs de spécialistes. En outre, la promotion de « chefs d’entreprise » sélectionne un certain type de profil (managérial, en particulier) qui n’a pas les moyens cognitifs qui lui permettraient de tout éplucher et de tout arbitrer.
Christian Topalov : Je suis tout à fait d’accord avec cette analyse. Mais ne croyons pas qu’il faut de grands moyens cognitifs pour diriger une université : si on appliquait aux présidents et à leur équipe, cabinet et chargés de mission, les critères bibliométriques (absurdes, il est vrai) par lesquels certains prétendent nous gouverner, le résultat serait, sans doute, du plus grand intérêt. Les vocations bureaucratiques saisissent surtout, je pense, les plus médiocres ou, soyons charitables, les plus fatigués. L’appétence pour le pouvoir et les honneurs n’est pas rare dans notre petit monde et le langage et les poncifs fournis par le sens commun réformateur permettent de masquer l’indigence de la pensée. Cela étant dit, vous avez raison : un bon président ne doit pas trop fâcher les collègues. Or, dans la majorité des universités, l’austérité auto-administrée a un coût politique pour les présidents et ils ont donc intérêt à n’être pas toujours en première ligne. Voyez, par exemple, comment ils utilisent les évaluations des unités de recherche par l’AERES-HCERES pour distribuer les crédits : les notes de l’agence les dispensent de mettre en discussion en interne, par des instances et procédures intelligentes, la production scientifique de leurs administrés. Quel soulagement ! D’autant que l’expérience leur a vite montré que l’autonomie revient surtout à administrer la pénurie, au fur et à mesure que les dotations ministérielles ne suivent pas le gonflement des effectifs étudiants et l’augmentation à l’ancienneté de la masse salariale. Sans compter que la dotation varie, depuis 2009, en fonction d’indicateurs de « performance » définis unilatéralement par le ministère : c’est le modèle dit, par antiphrase, « Sympa ». Depuis le moment Pécresse, celui du triomphe de la CPU, beaucoup de présidents ont donc déplané, tout en étant obligés de faire bonne figure : « Tu l’as voulu Georges Dandin ! ». À vrai dire, à partir du moment où la liste des Idex a commencé à prendre tournure, la majorité a découvert qu’ils étaient du côté des perdants et non des « excellents ». D’où un développement institutionnel intéressant : tandis que la supposée élite des universités s’organisait en 2013 dans la très sélective Coordination des universités de recherche intensive françaises (Curif), des universités qui n’acceptaient pas d’être déconsidérées formèrent en 2014 l’Alliance des universités de recherche et de formation (Auref). Cela suggère qu’heureusement, le monde des présidents d’université est hétérogène, ce qui donne un petit espoir pour le futur.

J’en viens justement à un second objectif, fondamental, de la réforme : casser l’université française en deux, séparer les excellents des autres, les gagnants des perdants. Il faut bien que la concurrence serve à quelque chose. On connaît l’argument : il faut faire naître en France des universités visibles depuis Shanghai et dans les classements internationaux. Comme si ces classements avaient plus d’importance pour le rayonnement international de ce pays que le réseau des Alliances françaises qui donnent accès à notre langue, les travaux de nos laboratoires connus des spécialistes du monde entier, les traductions de nos livres, les accords de coopération tissés à la base entre universités, la stabilité enviable que nos statuts offrent encore aux jeunes chercheurs étrangers. Balayant ce trésor d’expérience, les réformateurs ont voulu sélectionner, parmi les regroupements universitaires que la période Pécresse avait mis en route, une dizaine d’universités dites « d’excellence » susceptibles d’entrer dans la compétition internationale. La liste des élues a pu varier marginalement, ainsi que la composition des regroupements effectivement réalisés, mais le principe de la concentration des ressources au profit des « universités de recherche » a été mis en œuvre sans faiblesse. Research universities ? Notion étrangère au système français, puisque jusqu’à présent, toutes les universités font de la recherche. Latitude a été donnée aux dirigeants de ces regroupements pour disposer de toujours plus de pouvoirs au détriment des composantes et des universitaires eux-mêmes : c’est la « gouvernance resserrée ». Les ressources de ces universités – dévolution d’un patrimoine financier, dotations annuelles substantielles, financements sur projets abondants, moyens fournis de façon privilégiée par le CNRS – sont désormais sans commune mesure avec celles du commun des universités. C’est le « grand emprunt » de Sarkozy et la machinerie Idex qui a lancé le processus. Une division du travail efficace s’est mise en place. D’un côté, le ministère pilotait au plus près les regroupements d’universités, qui prenaient généralement la forme des PRES, montages institutionnels qui créaient un niveau de gouvernement nouveau, aussi indépendant que possible des universitaires, des personnels et des étudiants, toutes catégories dont les représentants, élus au deuxième degré, étaient non seulement minoritaires, mais désignés en fait par les chefs d’établissement. On partait donc d’un bon pied vers l’excellence en mettant l’état-major bien à l’abri des troupes. D’un autre côté, en 2010, un concours s’ouvrit : les chefs d’établissement et de PRES se réunissaient en conclave, faisaient appel à des consultants pour écrire leur projet et ne communiquaient surtout pas celui-ci à leur base car – ceci est un témoignage de première main – « la concurrence pourrait s’en saisir ». Un « jury international » fut mis en place par l’ANR pour sélectionner les futurs Idex. Deux bons Français y jouaient un rôle clef : l’économiste Philippe Aghion, consultant de Pécresse après l’avoir été de Raffarin – devenu « international » par son poste à Harvard – et le géophysicien Philippe Gillet, basculé dans l’administration universitaire à l’âge de 40 ans et à peine sorti du cabinet de Pécresse – devenu « international » par un job bureaucratique à l’École polytechnique de Lausanne. Ajoutez une vingtaine d’apparatchiks d’universités diverses, chantres de « l’assurance qualité » et cadres de Peugeot ou d’Areva et vous aurez la bande de gens qui a remodelé l’université française du xxie siècle. Il faudra attendre longtemps – témoignages ou archives – pour savoir comment ils ont travaillé. Mais les arguments publics justifiant leurs décisions parlent d’eux-mêmes : les candidats recalés ou ajournés l’étaient parce qu’ils n’assuraient pas une gouvernance suffisamment « resserrée » du regroupement, ni un degré suffisant d’intégration de ses composantes. On peut chercher longtemps dans ces oukases des considérations scientifiques ou concernant la formation. Le processus lui-même est bien intéressant – je m’en tiens ici aux décisions 2010-2018 dans le cadre du Programme investissements d’avenir 1 (PIA1) : il y a eu des candidats retenus d’emblée (Bordeaux, Strasbourg, Aix-Marseille, Sorbonne Universités) et il y a eu ceux qui ne l’étaient que de façon conditionnelle et devaient revoir leur copie (Paris Sciences et Lettres, Sorbonne-Paris-Cité, Paris-Saclay). Le jury était pédagogue : en agitant le hochet de l’excellence et des financements Idex, il obtenait des dirigeants des regroupements qu’ils se conforment à la doctrine et, accessoirement, qu’ils fassent taire leurs chamailleries. Seule Toulouse, insuffisamment disciplinée, fut finalement rejetée. Ainsi, on peut penser que, si c’était le ministère qui avait monté le « Meccano de la générale » – les regroupements à faire et à retenir –, le rôle dévolu au jury restait d’obtenir la soumission des candidats. C’était là un rôle important : faire inventer aux nouveaux patrons des Idex des formes de gouvernement vraiment indépendantes de la communauté universitaire. Il faut leur rendre hommage : ils ont fait preuve à cet égard d’une réelle créativité.
Olivier Orain : Ils étaient donc les acteurs in situ de ces mécanismes de donnant-donnant dont on a l’impression qu’ils sont en permanence en jeu dans ces principes réformateurs. C’est en permanence : « on va vous donner ça en plus mais à condition que vous vous pliiez à nos normes ».
Christian Topalov : Certes, mais on peut aussi penser que les leaders de chacun des PRES candidats n’étaient pas malheureux qu’on leur dise : « ce n’est pas mal, mais vous n’avez pas encore assez de pouvoir dans l’architecture que vous proposez ». Cela leur permettait de se retourner vers leurs mandants pour leur forcer un peu plus la main. À vrai dire, ça ne s’est pas toujours passé au mieux et on a vu des regroupements se fracasser sur ce problème, on a vu des sorties et des recompositions. Depuis, Macron a fait le nécessaire pour que tout rentre dans l’ordre : une ordonnance de décembre 2018 a permis aux regroupements de prendre la forme d’« établissement expérimental » où les composantes conservent leur personnalité morale, les statuts garantissant toutefois la conformité des décisions de chacune avec la « stratégie » de l’établissement. Plus quelques autres libertés avec le droit commun des universités. Très vite, la CPU a demandé l’extension de ces dispositions à l’ensemble des universités.
La mise en place des Idex – il y en a dix aujourd’hui (12) – a aussi été très importante pour fournir des fromages et des carrières à la couche bureaucratique de dirigeants qui a émergé au cours du processus de réforme. Je ne parle pas ici des administrateurs de base du tout-venant des universités – bien assis dans leurs fauteuils, cependant –, ni des autres petits soldats qui prolifèrent un peu partout dans le système, mais d’un groupe de deux douzaines d’individus – ceux qui ont piloté les réformes d’un bout à l’autre et que l’on retrouve, dans un jeu de chaises musicales rythmé par les changements de ministre, dans les postes d’état-major à différents niveaux : cabinets, directions d’administration centrale, direction des organismes, présidence des Idex. Un prototype de ce genre d’humanité est l’ineffable Thierry Coulhon : ancien vice-président de la CPU, il officia au cabinet de Pécresse puis au Commissariat général à l’investissement pour administrer le Plan Campus. L’élection de Hollande le conduisit à prendre des vacances en Australie, mais il revint vite occuper la présidence de Paris sciences et lettres (PSL) – où sa rémunération de 180 000 € bruts par an souleva un petit scandale –, conseilla ensuite Macron pendant sa campagne, puis entra dans le cabinet présidentiel qu’il est en train de quitter pour présider le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) (13). Je le soupçonne pourtant de regretter PSL, car c’est peut-être là que sont les meilleurs postes plutôt qu’au sommet du système.
Wolf Feuerhahn: Alain Fuchs est passé de la présidence du CNRS à celle de PSL. Pour moi c’est un indicateur très net.
Christian Topalov : C’est un très bon indicateur. J’en viens maintenant au troisième volet fondamental des réformes. C’est le pilotage politique de la recherche par l’ANR. Chronologiquement, c’est ce qui vient en premier, car l’ANR a été mise en place dès 2005. Cette réforme, comme la création de l’AERES deux ans plus tard, a bénéficié de la conjoncture magique créée par le mouvement « Sauvons la recherche » en janvier-mars 2004 et les Assises qui ont suivi à l’automne. C’était trop beau pour le gouvernement, qui a bien voulu rendre quelques postes qu’il venait de supprimer en contrepartie d’un bouleversement majeur du monde de la recherche. Figurez-vous qu’il y avait des chercheurs qui réclamaient : « on veut une agence de moyens, on veut de l’évaluation ». C’étaient des quadras biologistes qui souhaitaient secouer le joug de leurs patrons de labo et disposer de petites mains pour leurs travaux : ils voulaient des appels d’offres qui leur donneraient un accès direct aux ressources. Le ministère Fillon-d’Aubert a eu l’intelligence politique de foncer dans la brèche : c’est ce qu’il a appelé le « pacte pour la recherche ». Ce serait donc une agence de financement par projets, l’ANR, qui fournirait désormais les gros crédits, au détriment des dotations récurrentes des laboratoires, celles qui leur permettent de développer leur programme scientifique propre. Un pilotage politique de la recherche s’est ainsi mis en place. D’abord, en imposant des thèmes. Pour la biologie ou la physique, je suis incompétent pour en parler. Pour les SHS, on n’a pas encore fait l’analyse systématique des textes des appels d’offres, des projets reçus, retenus, écartés. Mais l’expérience commune montre que les candidats ont tout intérêt à utiliser le langage et à suivre les modes du moment, baptisées « enjeux de société » mais dont on se demande bien qui en a décidé. On relève, au fil des années, des thèmes qui permettent la promotion sans vergogne des sciences cognitives (création, enfance, apprentissage), d’imposer aux humanités d’être « numériques » si elles ne veulent pas être misérables, ou conduisent à reformuler les politiques publiques dans la novlangue des libéraux et de leurs services de police (« innovation », « vulnérabilité », « ville durable », « sécurité globale »). Bien sûr, quelques « programmes blancs » et, plus récemment, la politique des « projets génériques » entretiennent l’illusion que tous les sujets sont bienvenus. Mais il vaut mieux ne pas oublier d’insister sur la « transférabilité » des résultats et les partenariats avec le secteur privé, et de proclamer à chaque ligne que son projet est « innovant ». Le plus étonnant, dans tout ça, c’est que les chercheurs en SHS sont souvent assez malins pour produire des choses intéressantes malgré la chape de plomb qu’on met de cette façon sur leurs esprits.
Mais l’ANR n’impose pas simplement des thèmes, elle impose aussi des formes : la concurrence de tous contre tous, l’obligation d’annoncer ses résultats avant même d’avoir commencé la recherche, le calibrage financier uniforme de projets qui pourraient très bien demander moins, l’exécution du programme dans un temps généralement trop court, la promotion de petits leaders locaux qui disposent d’un budget parfois plus important que celui de leur labo et, surtout, le recrutement sans fin de précaires et l’effroyable gâchis de talents que cela entraîne. Comme il faut « avoir une ANR » pour disposer de moyens de travail et enrichir son CV, tout le monde se bouscule au même guichet, avec des taux de succès très faibles, alors que la mise sur pied d’un dossier nécessite un travail d’organisation important et une masse énorme de paperasse. Alors, les chercheurs protestent mais, au lieu de prendre acte de l’impasse où entraîne ce système de financement et d’exiger la création de postes et l’augmentation des budgets récurrents des laboratoires, certains demandent encore plus de crédits pour l’ANR afin de diminuer le taux de refus. C’est notamment la position de nombreux vieux messieurs qui furent jadis chercheurs ou enseignants qui oublient qu’ils doivent leur carrière au système révolu qui garantissait la stabilité de leurs emplois et la pérennité de leurs programmes (14). Mais c’est aussi la seule issue qu’imaginent nombre de jeunes chercheurs titulaires, voire de précaires qui préfèrent un énième « post-doc » à rien, car ils aiment leur métier et savent qu’ils pourraient le faire bien.
Wolf Feuerhahn : C’est le chercheur micro-entrepreneur.
Christian Topalov : Exactement. Il faudrait aussi parler des appels à projets administrés au niveau local, au sein des Labex – les supposés « laboratoires d’excellence » sélectionnés par un autre « jury international » de l’ANR et jamais évalués, si ce n’est par l’agence qui les a créés et ne peut évidemment pas se dédire. Ou, encore, au sein des Idex, où l’on ne peut quand même pas dépenser tout l’argent à entretenir la bureaucratie pléthorique qui se développe au sommet de ces institutions et où l’on rétribue des allégeances encore fragiles par des crédits de recherche en interne. Cette prolifération de petites principautés est profondément malsaine. Devant cette réalité, les vertueuses proclamations de l’agence de moyens sur les conflits d’intérêts sont une mascarade indécente.
Olivier Orain : On est entièrement d’accord.
Christian Topalov : Le quatrième et dernier aspect des réformes que je tiens pour important attaque, lui aussi, les valeurs et les croyances qui furent celles du monde de l’université et de la recherche : les réformateurs veulent nous faire acquérir ce qu’ils appellent « la culture de l’évaluation ». C’est la tâche de l’AERES, créée par le « pacte pour la recherche », reconduite par Fioraso et rebaptisée HCERES pour la protéger des critiques qui l’accablaient. Cette institution-là peut paraître relativement secondaire, parce que ce n’est pas excessif de dire que tout le monde se moque du HCERES. Après une douzaine d’années d’expérience, les gens ont fini par regarder cette agence pour ce qu’elle est : une machinerie bureaucratique qui nous oblige à remplir des questionnaires absurdes et à faire des rapports que personne ne lit et qui, sauf exception, émet des avis sans consistance, sinon celle du vocabulaire de management qui les soutient. Et pourtant, chaque fois qu’elle nous envoie ses « experts », on se plie à tous les exercices qui nous sont demandés. Le responsable d’une formation ou d’un laboratoire ne va pas prendre le risque de ne pas faire ce qu’il faut – y compris la fameuse autoévaluation, qui consiste en substance à faire semblant de se poser des questions qui ne se posent pas. Bien que déconsidérée dans le milieu, la machine à créer de la conformité ne marche pourtant pas trop mal. C’est la force des institutions.
La plus importante fonction de l’AERES-HCERES, c’est de reprogrammer les esprits, d’implanter dans nos cerveaux un nouveau logiciel. Universitaires et chercheurs, nous avons une longue et constante pratique : discuter de science. Nous débattons collectivement des articles reçus par nos comités de rédaction, des propositions de communication à nos colloques, des candidatures à des contrats doctoraux ou à des bourses d’échanges internationaux, des dossiers de ceux qui souhaitent être recrutés dans notre université ou s’agréger à nos unités de recherche. Nous discutons mémoires et thèses dans des jurys. Bref, évaluer collégialement est notre pain quotidien. Au fil de ces travaux, nous construisons, affûtons, renouvelons, transmettons une capacité collective à juger. Cette pratique commune, jointe aux compétences propres au domaine de chacun, permet à la communauté savante de s’auto-gouverner pour tout ce qui touche la science. C’est cette indépendance que l’AERES-HCERES a entrepris de faire oublier. Bien que l’agence de notation prétende qu’elle pratique, elle aussi, l’évaluation par les pairs, celle-ci n’est plus qu’une apparence avec une procédure qui commence par l’imposition d’un « guide de l’expert » ou « référentiel d’évaluation ». Désormais, les consultants en qualité posent les questions, les experts répondent, les bureaucrates de l’agence concluent.
Pour apercevoir cela plus nettement, on peut comparer les méthodes de l’AERES-HCERES à celles du Comité national de la recherche scientifique, qui a pour fonction d’évaluer le travail des chercheurs du CNRS et de classer les candidats à l’entrée. Et qui, jusqu’à ce que l’AERES s’empare de cette tâche, évaluait les unités de recherche du CNRS. On peut penser ce qu’on veut de la façon dont fonctionnent effectivement ses sections, qui ne sont pas toujours irréprochables, on n’a pas encore trouvé mieux pour évaluer sainement la recherche. Une section réunit une vingtaine de collègues, dont deux-tiers d’élus, pendant quatre ans. À chaque mandat, ils discutent de leurs critères et les publient. Pour chaque unité de recherche ou chercheur évalué, deux rapporteurs prennent connaissance du dossier, l’exposent à la section, doivent argumenter leur opinion devant leurs collègues qui, ensuite, arrêtent collectivement le rapport et votent l’avis (15). C’est ce qu’on peut appeler, après Nicolas Dodier, l’évaluation collégiale par jugement (16). Les mêmes principes sont à l’œuvre au CNU et, généralement, dans les conseils scientifiques des universités quand ils font bien leur travail. C’est cette façon de faire qu’a mise à bas l’AERES en s’appropriant le monopole de l’évaluation des formations de recherche. L’agence travaille par expertise : ses comités d’experts sont nommés par des gens eux-mêmes nommés par la direction de l’agence, ils doivent répondre aux questions et obéir aux normes que l’agence leur impose. Convoqués pour une seule mission, ils ont à peine le temps de se réunir au terme de leur visite et n’ont même pas la responsabilité du rapport final car celui-ci est arrêté au terme d’une « réunion de restitution » dirigée par les permanents de l’agence. La communauté est dessaisie de la production de ses normes, qui sont remises entre les mains de professionnels de la « démarche qualité ». Je ne résiste pas à l’envie de vous lire un bref extrait du premier « Manuel qualité » de l’agence, publié en 2010 : « L’AERES applique les références et lignes directrices pour l’assurance qualité dans l’espace européen de l’enseignement supérieur (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) adoptées à Bergen en 2005 par les ministres de l’enseignement supérieur des pays membres du processus de Bologne. Dans ce cadre, l’AERES s’engage à : mettre en œuvre un système de management de la qualité, fondé sur l’approche processus et adapté aux finalités de l’action de l’agence dans l’ensemble de sa structure et de ses activités » (17). C’est une autre langue, c’est un autre monde que le nôtre.

Bien entendu, ces gens, faute de lire, adorent compter : si les publications sont comptabilisées, leur contenu est décidément ignoré, tandis que le management des équipes est scruté avec soin. Ajoutez à cela la notation : A+, A, B, C. La notation, c’est fait pour classer et pour exclure. L’AERES-HCERES enrôle ainsi ses « experts » pour mettre en musique la concurrence libre et non faussée qui doit désormais régir ce que nous croyions être un service public. Toutes les agences de notation du monde se ressemblent, à cet égard : les notes de Moody’s et Standard & Poor’s sont performatives. Lorsque celle d’un État ou d’une entreprise est dégradée, le coût de ses emprunts s’élève et ses difficultés s’accroissent. Une agence de notation a toujours raison. C’est cela, la « culture de l’évaluation » qui doit reprogrammer nos esprits.
Une des conditions pour que ça marche, c’est marginaliser le Comité national de la recherche scientifique. Il s’agit de faire oublier que l’on peut évaluer autrement. C’est pourquoi le CoNRS n’est plus censé évaluer les unités de recherche. Et la direction du CNRS contribue à cet affaiblissement d’un contre-pouvoir chaque fois qu’elle balaie d’un revers de main les classements proposés par les sections pour les recrutements : ce n’est pas simplement un prurit autoritaire qui motive la bureaucratie de l’organisme, c’est une politique. Il s’agit de déconsidérer un peu plus une des rares institutions qui résiste encore au dévoiement de l’évaluation par la démarche qualité.
Olivier Orain : Les sections du CNU aussi, peut-être.
Christian Topalov : En effet. Déconsidérer, marginaliser, si possible liquider les deux institutions fondamentales de l’indépendance académique établies en 1945 apparaît donc, de fait, comme un des objectifs essentiels des réformateurs.
Notes
- En simplifiant à outrance, disons que la « sociologie des organisations », introduite en France par Michel Crozier, tend à regarder les institutions à diverses échelles comme des entités douées de raison stratégique (ce qu’adorent les cadres de celles-ci et, notamment, les hauts fonctionnaires) ; et que certaines versions extrêmes de l’« interactionnisme » considèrent que les jeux entre acteurs font et défont constamment des institutions considérées comme entièrement plastiques (ce qui présente l’avantage de disqualifier à la fois Foucault et la notion de « pouvoir », et Bourdieu et la notion de « violence symbolique »).
- La réunion des ministres de l’Éducation nationale ou de l’ESR qui a lancé les réformes universitaires s’est tenue à Bologne en juin 1999, à l’appel des signataires de la « déclaration de la Sorbonne » de mai 1998 (le Français Claude Allègre, l’Italien Enrico Berlinguer, la Britannique Tessa Blackstone et l’Allemand Jürgen Rüttgers).
- Philippe Aghion et Elie Cohen, « Éducation et croissance », rapport au Conseil d’analyse économique, Paris, Documentation française, 20 janvier 2004, p. 108-109.
- Règle budgétaire introduite par la Loi organique relative aux lois de finances (Lolf, 2001), qui permet d’utiliser des crédits de personnel à d’autres usages, mais interdit le déplacement inverse. Ainsi le nombre de postes de fonctionnaires peut être diminué, mais en aucun cas augmenté par les autorités qui mettent en œuvre le budget.
- Thierry Coulhon, « Bilan et perspectives de l’évaluation de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation : 2015-2025 », Colloque du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES), Université de Paris, 17 et 18 septembre 2019, p. 8, en ligne; Antoine Petit, « La recherche, une arme pour les combats du futur », Les Échos, 26 novembre 2019. Notons que, depuis 2016, l’Agence s’appelle Haut Conseil, audacieuse réforme due au gouvernement socialiste.
- Philippe Aghion, « L’excellence universitaire : leçons des expériences internationales », rapport d’étape de la mission Aghion à Mme Valérie Pécresse, ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche, 26 janvier 2010, en ligne.
- Un indice en est que plusieurs établissements, et non des moindres (Paris 1, Paris 2, Sciences Po, EHESS, École polytechnique, etc.), sont actuellement hors COMUE ou simplement « associés » à l’une d’elles (montage légalement possible, mais interdit de fait sous le ministère Fioraso) et semblent ne pas s’en porter plus mal.
- L’ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que les membres des sections du comité national sont nommés par le ministre sur proposition du directeur du CNRS ; l’élection est introduite ensuite : pour la moitié des membres en 1947 et pour les deux-tiers en 1982.
- La création de l’AERES en 2007 a privé le CoNRS de la mission d’évaluer les unités de recherche du CNRS ; les travaux préliminaires de 2019 à la Loi de programmation pluriannuelle de la recherche (LPPR) préparée par le ministère Vidal préconisent la suppression du CNU et donc de l’habilitation nationale à occuper les fonctions de maître de conférences ou de professeur et des promotions accordées par une autre instance que le président d’université.
- Voir Bruno Poucet et David Valence (éd.), La Loi Edgar Faure. Réformer l’université après 1968, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2016. Voir également Antoine Prost, « 1968 : mort et naissance de l’université française », Vingtième siècle, 23, juillet-septembre 1989, p. 59-70 et le n
o 26 de la Revue d’histoire des sciences humaines, Les « années 68 » des sciences humaines et sociales. - Ferry, philosophe et pionnier sur le thème, en fit un livre (Luc Ferry et Alain Renaut, La Pensée 68, Paris, Gallimard, 1988), Sarkozy et Pécresse furent plus concis : « Je veux tourner la page de Mai 1968 » (Nicolas Sarkozy, discours de campagne à Bercy, 29 avril 2007 ; Le Monde, 30 avril 2007, https://www.lemonde.fr/societe/article/2007/04/29/nicolas-sarkozy-veut-tourner-la-page-de-mai-1968_903432_3224.html) ; « Je propose aux Français de rompre réellement avec l’esprit, avec les comportements, avec les idées de Mai 68 […] de rompre réellement avec le cynisme de Mai 68 » (id., discours de campagne à Montpellier, 3 mai 2007 ; Le Monde, 4 mai 2007; « D’ici à 2012, j’aurai, je l’espère, réparé les dégâts de Mai 1968, qui avait cassé l’université. Pas seulement au sens propre en éclatant les disciplines dans des établissements séparés, mais aussi en instaurant une gouvernance illisible et en refusant la professionnalisation. » (Valérie Pécresse, entretien, Les Échos, 27 septembre 2010).
- Ceux cités plus haut et Nice, Grenoble et Lyon.
- Depuis que cet entretien a eu lieu, la nomination de Coulhon à la tête de l’HCERES, fortement contestée par un mouvement organisé d’universitaires et chercheurs, est devenue plus incertaine.
- Je vise ici les 180 signataires de la pétition de la « communauté scientifique » (rien moins que ça) demandant au président Macron une belle loi inégalitaire sur la recherche, publiée dans Le Monde du 20 février 2020 . Leur moyenne d’âge est 72 ans (voir « Quelques réponses aux questions fréquemment posées sur la loi de programmation pluriannuelle de la recherche (LPPR) », Groupe Jean-Pierre Vernant, http://www.groupejeanpierrevernant.info/#FAQLPPR, consulté le 11 juin 2020). Je crois pouvoir dire que cela n’est pas en soi un défaut, mais devient insupportable quand on condamne sans vergogne des cohortes de jeunes chercheurs et chercheuses à une précarité sans fin.
- En dépit du monopole attribué par la loi au HCERES, les sections du CoNRS continuent à examiner les dossiers des unités de recherche. Puisqu’« évaluer » leur est interdit, elles le font avec l’objectif de donner un « avis d’opportunité » sur le maintien des unités au sein du CNRS.
- Nicolas Dodier, « Penser un régime d’évaluation de la recherche scientifique », intervention lors du débat L’AERES et après ?, Paris, EHESS, 25 mars 2009.
- « Manuel Qualité de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur », mars 2010.
Premières publications :
Christian Topalov, « Qui gouverne la science ? Langage et acteurs des politiques de la recherche et de l’enseignement supérieur en France »,
Revue d’histoire des sciences humaines, 36 | 2020, 205-220.
Également disponible en version électronique.
Revue d’histoire des sciences humaines est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution 4.0 International.







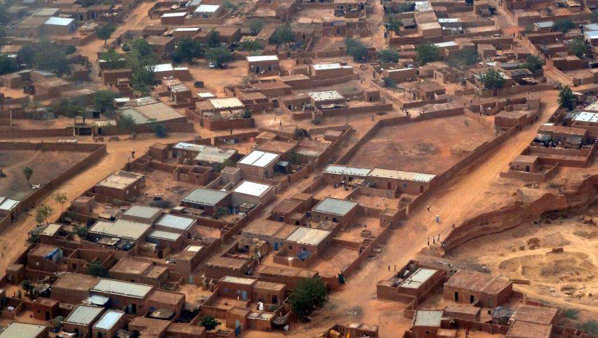 Les
Les  Alors que le
Alors que le  Entre octubre y diciembre de 2018, los
Entre octubre y diciembre de 2018, los 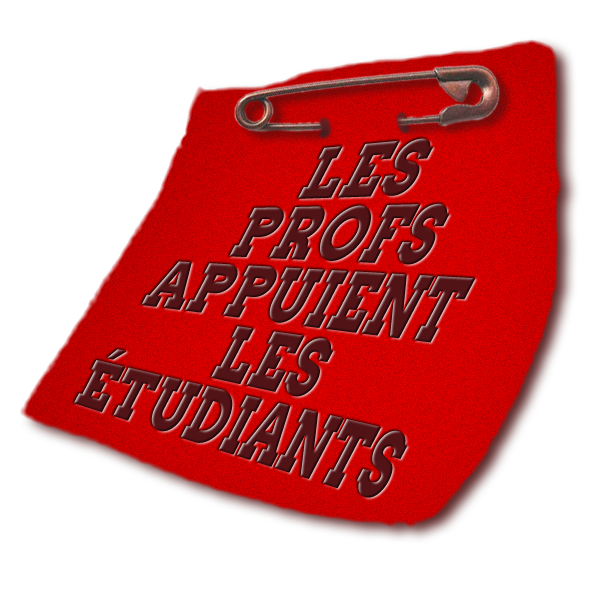 Le 19 novembre 2018, le Premier Ministre Édouard Philippe a annoncé l’augmentation des frais d’inscription des étudiants étrangers non-européens. La mesure, présentée comme un vecteur de ressources nouvelles dans une stratégie d’attractivité internationale des universités françaises, prévoit une hausse de près de 1600% de ces frais ! Pour s’y opposer, de nombreuses mobilisations se poursuivent dans tout le pays, organisées par les principaux syndicats (
Le 19 novembre 2018, le Premier Ministre Édouard Philippe a annoncé l’augmentation des frais d’inscription des étudiants étrangers non-européens. La mesure, présentée comme un vecteur de ressources nouvelles dans une stratégie d’attractivité internationale des universités françaises, prévoit une hausse de près de 1600% de ces frais ! Pour s’y opposer, de nombreuses mobilisations se poursuivent dans tout le pays, organisées par les principaux syndicats ( After the strikes against pension cuts in 2018 voted in 61 universities through the University and College Union (UCU) action,
After the strikes against pension cuts in 2018 voted in 61 universities through the University and College Union (UCU) action,