L’université française : mort sur ordonnance ?
Pendant que les regards se portaient sur Parcoursup, le gouvernement travaillait à remettre en cause les fondements mêmes du modèle de l’université française. Cette réforme a abouti mi-décembre 2018 avec l’adoption d’une ordonnance permettant aux universités de devenir des « établissements expérimentaux » qui dérogent au droit qui encadrait jusqu’à présent l’organisation et le mode de fonctionnement des universités. Cette ordonnance est l’aboutissement d’un long processus ; pour comprendre ce qui se joue, il nous faut effectuer un retour en arrière : 1968 et les réformes de ces dix dernières années.

Vers la fin d’un modèle organisationnel uniforme et démocratique ?
Lois Faure et Savary
L’université est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) fondé sur deux lois : la Loi Edgar Faure votée en novembre 1968 suite aux événements de Mai 68 et la loi Savary votée en 1984. L’objectif de la loi Faure était de créer des universités pluridisciplinaires (au lieu des facultés disciplinaires précédentes) structurées en Unités d’enseignement et de recherche (UER qui furent remplacées par des UFR, Unités de formation et de recherche, dans le cadre de la loi Savary). On y parle déjà d’autonomie administrative (détermination de leurs statuts et de leur organisation interne), pédagogique (en particulier dans le cadre des diplômes d’universités ou DU à côté des diplômes nationaux) et budgétaire, mais cette dernière sera très encadrée. Dans les facultés précédentes, seuls les Professeurs d’université siégeaient dans les conseils. Dans les nouvelles universités, le président est élu parmi les enseignants-chercheurs ; les conseils centraux comprennent des représentants des Professeurs d’université, des assistants et maîtres assistants (les ancêtres des maîtres de conférence), du personnel non-enseignant, des étudiants et des « personnalités extérieures ». Cette évolution, menée au nom de la participation, n’est pas propre à la France mais n’est pas présente dans tous les pays occidentaux, en Angleterre par exemple les conseils ne comprennent le plus souvent que des représentants des enseignants-chercheurs. On retrouve cette participation au niveau des conseils d’UFR et de départements.
Depuis la loi Savary, le conseil d’administration (cf. tableau ci-après) comprend de 30 à 60 membres (la plupart des universités ont opté pour des CA de près de 60 membres) : 40 à 45 % de représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ; 20 à 30 % de personnalités extérieures ; 20 à 25 % de représentants des étudiants ; 10 à 15 % de représentants des personnels non-enseignants. Le président est élu par les trois conseils, mais les personnalités extérieures sont proposées ou nommées après les élections du président.
Nous avons donc affaire à une entité publique à organisation interne démocratique sous la direction des enseignants-chercheurs (directeur de département, directeur d’UFR et président sont des enseignants-chercheurs) ; une organisation qui, s’y on y ajoute ses missions de diffusion des savoirs et de démocratisation de l’enseignement supérieur, était, au moins juridiquement et idéalement, une institution progressiste. Bien sûr, on pouvait faire de nombreuses critiques à ses modes de fonctionnement concrets, en particulier dire que les universités ne se sont jamais vraiment données les moyens de mettre en œuvre ce fonctionnement démocratique, en informant très peu sur ces caractéristiques – d’où un faible taux de participation étudiante aux élections –, en reconnaissant très peu le temps de travail généré par la fonction d’élu et en négligeant la formation des élus alors que les dossiers devenaient de plus en plus complexes – d’où une désaffection rapide des élus, en particulier côté étudiants, mais pas seulement.
À ce tableau doit être ajoutée une spécificité française : les universités partagent le champ public de l’enseignement supérieur et la recherche (ESR) avec d’une part les instituts de recherche (dont le CNRS), et d’autre part les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), intégrées dans les lycées, et les grandes écoles (écoles normales supérieures, école Polytechnique, des Mines, ENA, etc.). Cette séparation, en particulier entre université et CNRS, serait une des causes de notre faiblesse dans le classement de Shanghai (élaboré à partir de 2003).
Loi LRU et loi Fioraso
La loi relative aux libertés et responsabilités des universités (dite loi LRU ou loi d’autonomie des universités) est votée à l’été 2007 quand Nicolas Sarkozy arrive à la présidence, Valérie Pécresse étant alors ministre de l’ESR. On en retiendra ici trois éléments. Premièrement, partant du principe que le trop grand nombre de membres du CA crée lenteur et inefficacité, elle diminue ce nombre et accorde plus de poids aux personnalités extérieures. Les CA comprennent ainsi 20 à 30 membres (cf. tableau ci-après) ; une prime à la majorité est introduite : la moitié des sièges à pourvoir est attribuée à la liste majoritaire, le reste des sièges étant réparti à la proportionnelle. Deuxièmement, elle accorde beaucoup plus de pouvoirs au président qui n’est plus élu par les trois conseils (Loi Savary) mais par le seul CA. Troisièmement, elle accorde « l’autonomie budgétaire » par le « budget global » (comprenant la masse salariale, soit les salaires de tout le personnel statutaire, alors qu’auparavant les salaires des titulaires étaient pris en charge par le ministère et n’entraient pas dans le budget des universités).
La loi dite Fioraso – alors ministre de l’ESR sous la présidence de François Hollande – votée en 2013 augmente le nombre des représentants maximal de chaque catégorie au CA (cf. tableau ci-après) d’une à trois personnes ; la prime à la liste majoritaire est amoindrie mais maintenue. Le président est toujours élu simplement par le CA, mais les personnalités extérieures prennent dorénavant part à son élection (et pareillement au sein des conseils d’UFR).
Composition du CA
|
|
Enseignants-Chercheurs |
Personnalités extérieures |
Étudiants |
Personnel non-enseignant |
Total |
|
Université avant la LRU |
12 à 27 |
6 à 18 |
6 à 15 |
3 à 9 |
30 à 60 |
|
Université après la LRU |
8 à 14 |
7 ou 8 |
3 à 5 |
2 ou 3 |
20 à 30 |
|
Université après la Loi Fioraso |
8 à 16 |
8 |
4 ou 6 |
4 ou 6 |
24 à 36 |
La création de nouvelles structures
La notion de « site » est promue à partir de la fin des années 1990 et s’impose progressivement par la création des PRES (Pôles de recherche et d’enseignement supérieur) à partir de 2006. Les établissements situés dans une proximité géographique sont fortement incités à s’associer sous forme de PRES car certains financements ne sont disponibles que pour les PRES, et en particulier pour ceux se donnant comme objectif une fusion. Les premiers projets de fusion d’universités prennent corps dans la première moitié des années 2000 et se concrétisent en 2009 (Université de Strasbourg), 2012 (Université de Loraine et Aix-Marseille Université), 2014 (Bordeaux), 2015 (Montpellier), 2016 (Grenoble). La loi Fioraso rendra obligatoire pour tous les établissements de l’ESR relevant du ministère de l’ESR (universités, certaines grandes écoles, certains organismes de recherche dont le CNRS) l’appartenance à un regroupement d’établissements sous forme de fusion, d’appartenance ou d’association à une Comue (Communauté d’universités et établissements). Les modes de regroupements, d’organisation interne, de délégation de compétences sont très divers d’une Comue à l’autre ; on a clairement abandonné le modèle d’organisation unique.
La création de ces nouvelles structures visaient la création de synergies locales, le dépassement des frontières universités/CNRS/grandes écoles et/ou la création d’empires universitaires dans l’objectif annoncé dès 2007 dans la lettre de mission de N. Sarkozy à V. Pécresse « d’amélioration du rang de nos établissements d’enseignement supérieur dans les classements internationaux », puis de « faire émerger sur le territoire français 5 à 10 pôles pluridisciplinaires d’excellence de rang mondial ».
De ces deux phénomènes LRU et fusion, l’évolution de la représentation au sein d’une université fusionnée, telle que celle d’Aix-Marseille issue de trois universités, si l’on s’en tient au seul CA, est la suivante :
Composition des CA à Aix-Marseille
|
|
Enseignants-Chercheurs |
Personnalités extérieures |
Étudiants |
Personnel non-enseignant |
Total |
|
Aix-Marseille 1 avant application de la LRU1 |
12 à 27 |
6 à 18 |
6 à 15 |
3 à 9 |
30 à 60 |
|
Aix-Marseille 2 avant application de la LRU1 |
12 à 27 |
6 à 18 |
6 à 15 |
3 à 9 |
30 à 60 |
|
Aix-Marseille 3 avant application de la LRU1 |
12 à 27 |
6 à 18 |
6 à 15 |
3 à 9 |
30 à 60 |
|
Total avant application de la LRU |
36 à 81 |
18 à 54 |
18 à 45 |
9 à 27 |
90 à 180 |
|
Aix-Marseille Université en 2018 (75 000 étudiants, 8 000 personnels) |
16 |
8 |
6 |
6 |
36 (dont 83% d’élus des personnels et usagers |
1 N’ayant pas retrouvé la composition réelle de chaque CA avant la fusion, nous nous basons sur le cadre de la loi Savary.
On voit clairement la réduction du nombre des élus et du nombre de personnalités extérieures, et donc la diminution de la représentation de la diversité des membres de la communauté universitaire et de ses partenaires, d’autant que l’on retrouve le même phénomène aux niveaux « inférieurs » de l’organisation avec la diminution du nombre d’UFR par rapport à la situation avant fusion.
PIA3, Loi Confiance et ordonnance du 12 décembre 2018
Les dernières évolutions vont beaucoup plus loin. L’utilisation du Grand Emprunt comme levier pour redessiner le paysage universitaire français se confirme avec le PIA 3 (Troisième vague du Grand Emprunt ou Plan d’investissement d’avenir n°3). Lancé en février 2017 (sous la présidence de F. Hollande), il comporte plusieurs volets. Comme pour chaque PIA, ce sont des financements sur appel à projets. Le PIA 3 comporte une « action » « Grandes universités de recherche », le mot d’ordre est à la « simplification institutionnelle », à « l’expérimentation de modes d’organisation » et à la « construction d’université de type nouveau ». Le PIA 3 comporte également un appel « écoles universitaires de recherche » (EUR), qui rassembleront des formations de master et doctorat et des laboratoires de recherche.
La loi du 10 août 2018 « pour un État au service d’une société de confiance », ensemble de choses très disparates (dont le droit à l’erreur pour le contribuable), comporte un article 52 : « le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi destinées à expérimenter de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche ». L’« avant-projet d’ordonnance » a été dévoilé par la presse début septembre, un nouvel avant-projet a été rendu public le 8 octobre, présenté en Conseil des ministres le 12 décembre et publié au Journal officiel le lendemain, 13 décembre. Comme l’indiquait dès le 15 octobre la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Frédérique Vidal : « L’objectif est une publication avant la fin du mois de décembre pour que les établissements puissent s’en saisir dès le début de l’année 2019 ». Ces « établissements expérimentaux » pourront regrouper ou fusionner des établissements de l’ESR publics et privés ; on va ainsi plus loin que le dépassement des frontières universités/CNRS/grandes écoles. Leur organisation sera fixée par leurs statuts (aucune référence à des UFR ou à un mode particulier de structuration interne), tout comme le titre, mode de désignation, et compétences du chef d’établissement (la limite d’âge de 68 ans disparaît). La composition de leur CA (« ou de l’organe en tenant lieu ») est cadrée a minima : « au moins 40% de représentants élus des personnels et usagers, ainsi que des personnalités extérieures. Il peut comprendre d’autres catégories de membres ». 40% de représentants élus, ils seraient donc minoritaires et représenteraient moins de la moitié de ce qu’ils représentent dans le cadre de la loi Fioraso (cf tableau ci-dessus). On peut se demander quelles seraient les « autres catégories de membres » : ni des représentants élus des personnels et usagers ni des personnalités extérieures, donc à priori des membres de la communauté universitaire ou éducative non élus, donc nommés (par qui ?). Les conséquences de la coexistence d’établissements publics et privés sur la gestion des personnels et sur le droit à délivrer les diplômes nationaux restent largement indéterminées.
Comme l’indique Emmanuel Roux, président de l’Université de Nîmes à la tête de la commission juridique de la CPU (Conférence des présidents d’université) : « le président de l’établissement peut ne pas être enseignant-chercheur, il peut ne pas être élu, exercer un nombre de mandats illimités d’une durée de cinq ans. Il n’y a pas de nombre minimal ou maximal de membres du CA ». Au bout de deux ans, l’établissement peut demander à sortir de ce statut dérogatoire pour accéder, par exemple, à celui de « grand établissement ».
Le CNESER (Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche) du 16 octobre a voté majoritairement contre le projet d’ordonnance : 46 contre, 9 pour et 8 abstentions, tout comme le CTMESR (Comité technique ministériel de l’enseignement supérieur et de la recherche) du 6 novembre (11 voix contre et 2 abstentions) ; mais leurs avis ne sont que consultatifs.
D’après la ministre interviewée le 15 octobre : « De nombreux sites se sont déjà manifestés (pour s’inscrire dans le projet d’ordonnance) et ils sont très divers. Nous avons bien sûr des demandes qui émanent des établissements qui ont été lauréats des PIA, Idex et Isite. (…) Mais il y aussi beaucoup d’intérêt du côté des sites qui tirent parti de l’ordonnance pour formaliser les relations qu’ils avaient déjà avec des écoles ou des Comue qui souhaitent évoluer ».
Parmi les lauréats des PIA, l’Université de Paris (regroupant Paris 5, 7 et l’IPGP) devrait voir le jour dans ce cadre au 1er avril 2019, l’Université de Lyon et l’Université Côte d’Azur (UCA) – pour l’instant des Comue – au 1er janvier 2020, tout comme l’Université intégrée de Grenoble. Le choix de l’UCA a été présenté en début d’année 2018 aux membres de l’université, elle serait constituée de « collèges universitaires préparatoires » qui gèreraient les licences, d’EUR qui gèreraient les masters et doctorats ; aucune mention des UFR, le conseil de l’UFR Lettres Arts et Sciences humaines de l’UCA a voté une motion en janvier demandant à ce que la constitution de ce grand établissement ne soit pas fondé sur la suppression des UFR (et donc de leurs conseils élus). La même crainte est exprimée par la Conférence des doyens et directeurs des UFR scientifiques (CDUS) à propos de l’Université de Lyon. Des Comue regroupant de plus petites universités ont également fait part de leur souhait d’aller vers le statut d’établissement dérogatoire : la Comue Bourgogne Franche Comté, la Comue Normandie Université, les universités du Mans et d’Angers, etc.
Vers la fin d’un modèle de financement ?
Sous-financement chronique
Selon France Stratégie, « la dépense moyenne par étudiant est en France à un niveau proche de la moyenne de l’OCDE (un peu plus de 15 000 USD/an), mais bien inférieure aux niveaux atteints par les pays qui dépensent le plus (Canada, États-Unis, Norvège, Suède, Royaume-Uni, Suisse, pays où cette dépense dépasse les 20 000 USD) et par les pays les plus ‘performants’ (18 000 USD en moyenne) ». Cette moyenne cache par ailleurs des différences de situations importantes, déjà entre universités et classes préparatoires aux grandes écoles : en 2016 environ 10 000 € par an pour un étudiant à l’université et environ 15 000 pour un étudiant en classes préparatoires aux grandes écoles. La moyenne universitaire cache également des disparités importantes entre BTS et filières universitaires et au sein de ces dernières entre disciplines : les UFR et filières de droit/éco/gestion et arts/lettres/langues et sciences humaines étant moins bien loties que celles de sciences et de médecine. Malgré un discours ministériel égalitaire, les inégalités étaient importantes entre UFR et universités (selon leur dominante Droit, LSH ou sciences), le monde universitaire était donc lui-même divisé et hiérarchisé.
Ce sous-financement signifie un sous-encadrement enseignant et administratif. En 2007, tous les acteurs (dont la Conférence des Présidents d’Université et le ministère) reconnaissaient la nécessité d’une augmentation de budget d’un milliard par an, hors recherche, sur au moins 5 ans pour remédier à ce sous-financement. En novembre 2007, un protocole-cadre signé entre le Premier ministre et la CPU prévoyait ce financement, mais l’engagement n’a pas été tenu. Depuis 2012, le budget de l’enseignement supérieur est, en euros constants en stagnation, alors que le nombre d’étudiants a augmenté en 10 ans de plus de 400 000 individus. Thomas Piketty a estimé que le budget par étudiant a diminué de près de 10% entre 2008 et 2018. Le budget 2019 pour l’enseignement supérieur et la recherche universitaire prévoit une augmentation de 166 millions soit + 1,2%, moins que l’inflation (prévue au minimum à 1,3%), donc un budget qui va continuer à stagner ou baisser en euros constants et une dépense par étudiant qui va continuer à baisser, d’autant que le ministère prévoit au minimum 30 000 étudiants (l’équivalent d’une grosse université moyenne) supplémentaires par an pour les cinq prochaines années.
Ces questions de sous-financement et sous-encadrement enseignant et administratif de l’université n’ont pas été abordées dans le cadre de la loi ORE pour laquelle le gouvernement a considéré que le problème était essentiellement celui de la « mauvaise orientation ». Or ce sous-financement a été aggravé par la dévolution de la masse salariale aux universités dans le cadre de la loi LRU avec un « Glissement vieillesse technicité » (GVT) sous-évalué et sous-financé par l’État.
Mise en compétition
La mise en compétition des universités en matière de financement s’est réalisée par la mise en place d’un financement à la performance et d’un financement par projets.
Le financement à la performance est introduit en 2009, dans le cadre de la Révision générale des politiques publiques, par un nouveau modèle de répartition du budget « récurrent » appelé Sympa (SYstème de répartition des Moyens à la Performance et à l’Activité) : la somme allouée par le ministère à chaque université est calculée à partir d’un certain nombre d’indicateurs de « performance », tel que le taux de réussite en licence, le nombre d’enseignants chercheurs « publiants », etc. Comme cette répartition se réalise sur la base d’un budget national non extensible, la meilleure « performance » et l’augmentation de budget des uns signifie une baisse de budget des autres, il ne suffit donc pas d’être très « performant » mais il faut être plus performant que son voisin, au sens où la performance a été définie. Ce modèle Sympa a été mis en sommeil en 2013, on ne connaît pas aujourd’hui les critères de répartition du budget. Avant Sympa, le budget était réparti sur la base des « normes San Remo » dans une optique plutôt de traitement égalitaire, et en fonction des besoins : nombre d’étudiants, nombre de personnel (enseignants-chercheurs et non-enseignants), nombre de m2 à entretenir…
Le financement par projets s’est installé d’abord en matière de recherche, rappelons que c’était une des raisons de la grève des chercheurs de 2003 et de la création de Sauvons la Recherche. Il s’est ensuite développé dans le cadre des « ressources extra-budgétaires », soit hors budget alloué par Sympa : Plan Campus (2007-2008) et Grand Emprunt (PIA 1, 2 et 3 lancés en 2010, 2015 et 2017, et leurs « politiques d’excellence » : Idex, Labex…). Depuis le PIA3, ce financement par projet s’est étendu à la formation : « développer l’innovation pédagogique », « nouveaux cursus à l’université ».
À noter que ces deux formes de mise en compétition ont été développées en interne dans de très nombreuses universités.
 On change ainsi de logique : d’un financement, certes insuffisant, mais défini en fonction des besoins, on passe à un financement en fonction de la performance et de l’excellence. L’égalité de traitement n’est plus revendiquée, même si elle n’était pas complètement en œuvre, c’est la spécialisation et la différenciation qui sont recherchées et célébrées. Le financement par projet signifie du temps de travail très important pour monter ces projets, particulièrement complexes pour les PIA ; c’est un mode de financement consommateur de ressources pour des montants qui au bout du compte ne semblent pas si importants que cela, d’autant que plusieurs universités ont recruté des cabinets privés pour les aider à monter ces projets : l’Université de Lyon a ainsi attribué en mai 2018 quatre lots de marchés publics à deux cabinets de consultants d’un montant de 900 000€ pour l’accompagner sur deux ans dans la mise en place de son nouvel établissement. Ces deux modes de financement ont finalement des effets de concentration des ressources sur ceux qui étaient souvent au départ déjà les mieux dotés. Le rapport du Comité Action publique (CAP) 2022 appelle à les développer, à rendre les financements « plus incitatifs » et imaginent que les appels à projets puissent se substituer intégralement aux subventions actuelles.
On change ainsi de logique : d’un financement, certes insuffisant, mais défini en fonction des besoins, on passe à un financement en fonction de la performance et de l’excellence. L’égalité de traitement n’est plus revendiquée, même si elle n’était pas complètement en œuvre, c’est la spécialisation et la différenciation qui sont recherchées et célébrées. Le financement par projet signifie du temps de travail très important pour monter ces projets, particulièrement complexes pour les PIA ; c’est un mode de financement consommateur de ressources pour des montants qui au bout du compte ne semblent pas si importants que cela, d’autant que plusieurs universités ont recruté des cabinets privés pour les aider à monter ces projets : l’Université de Lyon a ainsi attribué en mai 2018 quatre lots de marchés publics à deux cabinets de consultants d’un montant de 900 000€ pour l’accompagner sur deux ans dans la mise en place de son nouvel établissement. Ces deux modes de financement ont finalement des effets de concentration des ressources sur ceux qui étaient souvent au départ déjà les mieux dotés. Le rapport du Comité Action publique (CAP) 2022 appelle à les développer, à rendre les financements « plus incitatifs » et imaginent que les appels à projets puissent se substituer intégralement aux subventions actuelles.
De manière générale, les universités sont d’autre part confrontées à des transferts de ressources entre leurs différentes activités, en lien avec la LRU (renforcements des fonctions DRH, finance et juridique qui ont nécessité une augmentation du personnel dédié, certification des comptes par des cabinets privés), en lien avec la politique de différenciation-positionnement-attractivité (augmentation des budgets communication par exemple, labellisation de différents ordres). On peut sur ces derniers points parler de processus de prédation des ressources publiques. Il faudrait pouvoir mieux mesurer ces transferts de ressources et ces processus de prédation, c’est un de mes projets de recherche. On peut en tout cas s’attendre à ce qu’ils se développent : l’Université de Lyon (UL) rémunère ainsi la participation des personnalités extérieures à son Scientific Advisory Board : sa présidente, directrice du cabinet consultant Reichert Higher Education Consulting, a ainsi reçu 10 000€ pour la réunion du 15 novembre 2017 (correspondant d’après l’arrêté signé par le président de l’UL à 40h de travail) tandis que les quatre autres membres externes recevaient entre 2500 et 4000 €. Le fait que les directeurs des établissements dérogatoires ne soient plus forcément des enseignants-chercheurs ne pose pas seulement une question de collégialité : s’ils ne sont pas fonctionnaires quel sera leur niveau de salaire (non soumis à la grille de la fonction publique) ? Le salaire de certains présidents de Comue avaient déjà surpris : tel celui du président de la Comue Paris Sciences et Lettres de 2015 à 2017 qui était de l’ordre de 150 000€ nets annuels. Cela rappelle les mécanismes d’extraction des profits de leurs universités mis en place par les vice-chancelors à partir des années 2000 en Angleterre, mais aussi aux États-Unis, en Australie, etc.
Tout cela, rappelons-le, dans un contexte de sous-financement chronique alourdi par la LRU. Face à cela, les universités font le choix très contraint de geler et/ou, pour les postes d’enseignants-chercheurs, « atériser » ou contractualiser des postes, il y a donc eu le développement d’emplois de non-fonctionnaires de différentes formes. La LRU avait déjà permis l’embauche de maîtres de conférences (MCF) contractuels ; les nouveaux établissements dans le cadre du PIA3 vont renforcer cela : plusieurs des dossiers de candidature font état d’embauche sous forme de « MCF tenure tracks » (a minima les projets de Lille et de Lyon) que l’on pourrait traduire par « titularisation conditionnelle après une période d’essai », aux États Unis cette période est souvent de 6 ans pour une titularisation d’environ 50%, à Sciences Po Paris qui a adopté cette modalité de recrutement depuis 2009 elle est, au maximum, de 7 à 9 ans.
Augmentation des ressources propres
Depuis de nombreuses années, le ministère incite les universités à augmenter leurs « ressources propres » : contrats de recherche, prestations de formation continue, diverses prestations de service. Quid alors des droits d’inscription ? Le gouvernement a annoncé le 19 novembre leur augmentation pour les étudiants extracommunautaires, les passant de 170€ à 2 770 €/an pour le niveau Licence et de 243€ / 380€ à 3 770 €/an pour les niveaux Master/Doctorat. On le savait peu mais la libre fixation par chaque université des droits d’inscription pour ses étudiants étrangers hors Union européenne avait été rendue possible par un décret du 30 avril 2002 ; leur augmentation annoncée ne semble pas nécessiter de vote parlementaire, elle figure déjà sur Campusfrance.org, le site officiel du gouvernement à destination des étudiants étrangers. On pourrait penser qu’un tel choix ne remet pas en cause les principes d’un financement basé sur la subvention de l’État financée par l’impôt, puisque les parents de ces étudiants ne paient pas d’impôts en France ou en Europe. N’oublions pas toutefois deux éléments. Premièrement, cette décision prise en Angleterre en 1979 sous le gouvernement de Margaret Thatcher a constitué le premier pas de l’augmentation des droits d’inscription pour tous (aujourd’hui £9 000 annuels pour les étudiants anglais et européens, du moins jusqu’à la mise en œuvre du Brexit). Deuxièmement, une telle décision transforme foncièrement les pratiques et les choix des universités, elle les fait entrer dans une logique de marché : attirer le plus possible de ces étudiants, donc faire de la communication, de la publicité, etc.
 Quant aux droits d’inscription des étudiants français et européens, la Cour des comptes a réalisé, à la demande du président de la commission des finances de l’Assemblée nationale, un rapport rendu public fin novembre 2018. Pour la Cour, le scénario le plus « réaliste et acceptable » serait celui d’une « hausse modulée des droits en fonction du cycle d’études », « en priorité en master ». Le premier ministre a déclaré le 21 novembre que ce n’était pas le projet du gouvernement. Mais la possibilité existe déjà à travers les diplômes d’universités (DU) ou diplômes d’établissements (DE), possibilité à laquelle pourraient recourir de nombreux établissements dérogatoires pendant leur phase transitoire puis en tant que grand établissement. C’est le cas de l’Université Côte d’Azur (UCA) qui a mis en place à la rentrée 2018 onze diplômes d’établissements au niveau Bac+5 (des MSc ou Master of Science) à 4000 € de frais d’inscription annuels, dont certains seraient venus en remplacement de diplômes nationaux de Masters rattachés à l’Université de Nice Sophia Antipolis, mais enseignés en anglais ; y enseignent des enseignants-chercheurs de l’université (sur leur service ?) et des enseignants de l’école privée Skema Business School, membre à venir du nouvel établissement. Comme l’indique l’UCA, « un étudiant ayant obtenu un DE Idex peut demander la validation d’une équivalence vers un diplôme national (tel qu’un master) suivant la procédure dite de « validation des études supérieures » (VES). Cette validation réalisée par une commission mixte, composée du directeur de Master dans un domaine disciplinaire équivalent et d’enseignants chercheurs de l’université est une possibilité offerte qui n’est pas systématique ». Le CNESER a rejeté l’accréditation des masters et doctorats de l’UCA le 14 février 2018, mais son avis n’est que consultatif. Ce procédé d’instauration de frais de scolarité élevés ne nécessite donc aucun changement législatif, on peut s’attendre à ce qu’il se développe dans le cadre des établissements dérogatoires, non seulement au niveau Bac+5 mais également au niveau Bac+3 car plusieurs candidatures « Grandes universités de recherche » annoncent la création de « bachelors ».
Quant aux droits d’inscription des étudiants français et européens, la Cour des comptes a réalisé, à la demande du président de la commission des finances de l’Assemblée nationale, un rapport rendu public fin novembre 2018. Pour la Cour, le scénario le plus « réaliste et acceptable » serait celui d’une « hausse modulée des droits en fonction du cycle d’études », « en priorité en master ». Le premier ministre a déclaré le 21 novembre que ce n’était pas le projet du gouvernement. Mais la possibilité existe déjà à travers les diplômes d’universités (DU) ou diplômes d’établissements (DE), possibilité à laquelle pourraient recourir de nombreux établissements dérogatoires pendant leur phase transitoire puis en tant que grand établissement. C’est le cas de l’Université Côte d’Azur (UCA) qui a mis en place à la rentrée 2018 onze diplômes d’établissements au niveau Bac+5 (des MSc ou Master of Science) à 4000 € de frais d’inscription annuels, dont certains seraient venus en remplacement de diplômes nationaux de Masters rattachés à l’Université de Nice Sophia Antipolis, mais enseignés en anglais ; y enseignent des enseignants-chercheurs de l’université (sur leur service ?) et des enseignants de l’école privée Skema Business School, membre à venir du nouvel établissement. Comme l’indique l’UCA, « un étudiant ayant obtenu un DE Idex peut demander la validation d’une équivalence vers un diplôme national (tel qu’un master) suivant la procédure dite de « validation des études supérieures » (VES). Cette validation réalisée par une commission mixte, composée du directeur de Master dans un domaine disciplinaire équivalent et d’enseignants chercheurs de l’université est une possibilité offerte qui n’est pas systématique ». Le CNESER a rejeté l’accréditation des masters et doctorats de l’UCA le 14 février 2018, mais son avis n’est que consultatif. Ce procédé d’instauration de frais de scolarité élevés ne nécessite donc aucun changement législatif, on peut s’attendre à ce qu’il se développe dans le cadre des établissements dérogatoires, non seulement au niveau Bac+5 mais également au niveau Bac+3 car plusieurs candidatures « Grandes universités de recherche » annoncent la création de « bachelors ».
Soulignons, pour terminer cette partie « économique », que cette non augmentation du budget (et sa diminution par étudiant) est un choix politique et non une « simple » contrainte liée au déficit de l’État, car ces dix dernières années correspondent également au choix continu de laisser augmenter les « dépenses fiscales » (ou réductions d’impôts), en particulier le Crédit impôt recherche (CIR) qui bénéficie surtout aux grandes entreprises et aurait largement bénéficié au secteur des services (banques, assurance, conseil…) ; la Cour des comptes a réalisé il y a déjà cinq ans un rapport très critique en la matière. Pour 2017, le CIR serait d’au moins 5,7 milliards, soit presque la moitié du budget de toutes les universités et assimilés de France masse salariale comprise (un peu plus de 13 milliards).
Conclusion
Un certain nombre d’éléments étaient déjà en place (arrêté concernant les droits d’inscription des étudiants étrangers, validation des études supérieures, etc.), d’autres au cœur de ce qui a fait l’université française : l’accès pour tout bachelier, le statut d’université avec son mode d’organisation démocratique et collégial, le statut de fonctionnaire d’une grande partie de ses personnels, et le montant des droits d’inscription extrêmement bas et décidé par arrêté ministériel, sont en train d’être détruits par contournement. Nous sommes à l’aube d’une transformation radicale des universités françaises, processus qui pourrait être très rapide.
La candidature de Toulouse au PIA 3, non retenue, était très claire quand elle expliquait, en septembre 2016, son choix du statut de « grand établissement » : « Le statut de grand établissement permet de déroger au droit commun des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) (…). Les grands établissements sont créés par décret en conseil d’État ; ce décret devient la charte de l’établissement. Ce statut peut présenter des spécificités portant sur la nomination du directeur, la présence importante de personnalités extérieures au sein du conseil d’administration, l’allocation directe (ou non) des dotations, la sélection des étudiants à l’entrée des formations, la possibilité de délivrer des diplômes propres et des mastères spécialisés soumis à des frais d’inscription différents de ceux des diplômes nationaux, les relations avec les milieux professionnels ».
Il s’agit indubitablement d’un nouveau modèle. Pour ceux qui le trouvent inacceptable, que faire ? Déjà être informés, c’est l’objectif de ce texte. Du fait de l’ordonnance, le processus échappe au débat parlementaire, les transformations seront locales, réglées au cas par cas sans grande publicité ; tout est fait pour désamorcer la contestation et rendre la lutte collective difficile.
Corine Eyraud est maître conférences en sociologie à l’Université d’Aix-Marseille et chercheuse au Laboratoire d’Économie et de Sociologie du Travail (LEST). Son article, dans sa version complète, a été publié dans le n° 47 de la revue Savoir/Agir http://www.editions-croquant.org/les-collections/product/534-pdf-revue-savoir-agir-n-47 et nous remercions vivement son comité de rédaction qui en a autorisé la diffusion. Le texte intégral peut également être téléchargé sur http://www.lest.cnrs.fr/spip.php?article1202



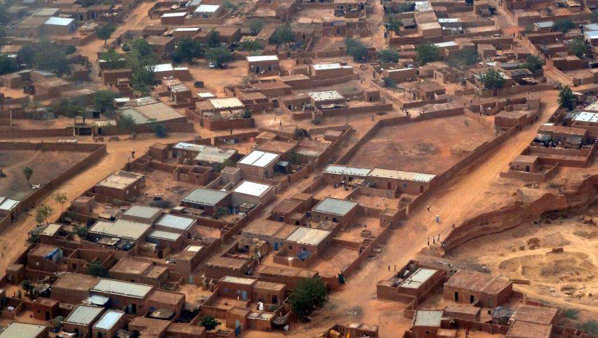 Les
Les  Alors que le
Alors que le  Entre octubre y diciembre de 2018, los
Entre octubre y diciembre de 2018, los 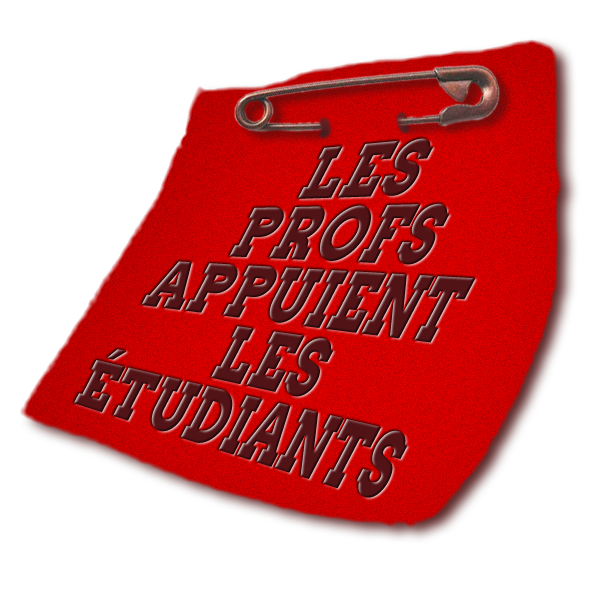 Le 19 novembre 2018, le Premier Ministre Édouard Philippe a annoncé l’augmentation des frais d’inscription des étudiants étrangers non-européens. La mesure, présentée comme un vecteur de ressources nouvelles dans une stratégie d’attractivité internationale des universités françaises, prévoit une hausse de près de 1600% de ces frais ! Pour s’y opposer, de nombreuses mobilisations se poursuivent dans tout le pays, organisées par les principaux syndicats (
Le 19 novembre 2018, le Premier Ministre Édouard Philippe a annoncé l’augmentation des frais d’inscription des étudiants étrangers non-européens. La mesure, présentée comme un vecteur de ressources nouvelles dans une stratégie d’attractivité internationale des universités françaises, prévoit une hausse de près de 1600% de ces frais ! Pour s’y opposer, de nombreuses mobilisations se poursuivent dans tout le pays, organisées par les principaux syndicats ( After the strikes against pension cuts in 2018 voted in 61 universities through the University and College Union (UCU) action,
After the strikes against pension cuts in 2018 voted in 61 universities through the University and College Union (UCU) action,  Tandis que le peuple algérien se mobilise tous les vendredis depuis plus d’un mois pour appeler au retrait de la candidature du Président candidat pour un 5ème mandat et en finir avec le système du FLN, les étudiants
Tandis que le peuple algérien se mobilise tous les vendredis depuis plus d’un mois pour appeler au retrait de la candidature du Président candidat pour un 5ème mandat et en finir avec le système du FLN, les étudiants